 Insee Première ·
Mai 2025 · n° 2051
Insee Première ·
Mai 2025 · n° 2051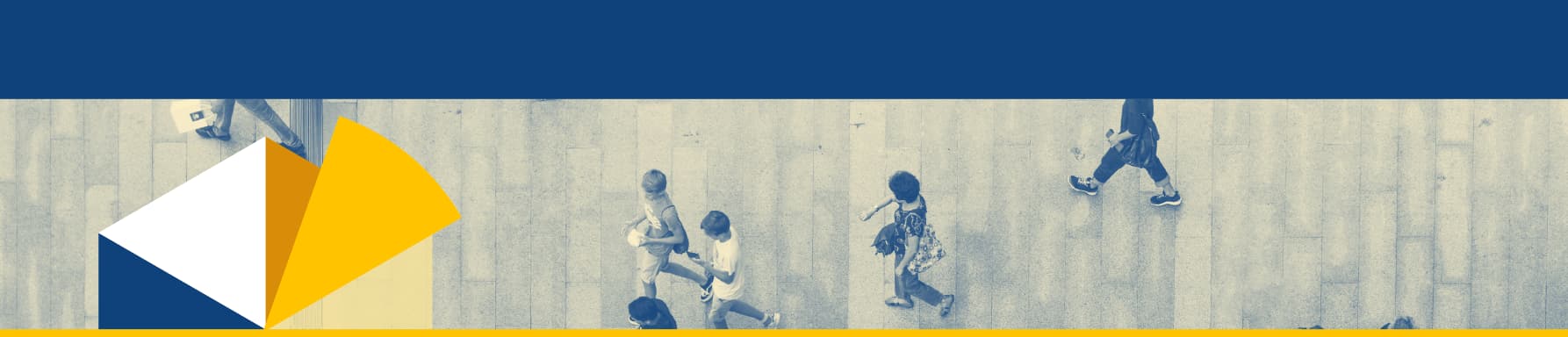 Entre 2006 et 2023, le nombre d’immigrés entrés en France augmente et leur niveau
de diplôme s’améliore
Entre 2006 et 2023, le nombre d’immigrés entrés en France augmente et leur niveau
de diplôme s’améliore
En 2023, 347 000 personnes immigrées sont arrivées en France, contre 234 000 en 2006. Sur cette période, les entrées sur le territoire de personnes immigrées ont tendanciellement augmenté et ont aussi été le reflet des chocs économiques, géopolitiques et sanitaires qu’a connu le monde.
Les origines migratoires se sont diversifiées : en 2023, l’Europe était le continent de naissance de 28 % des nouveaux immigrés, contre 44 % en 2006. L’Afrique est désormais le premier continent d’origine, représentant 45 % des entrées de personnes immigrées en France en 2023.
La part des femmes dans les entrées d’immigrés sur le territoire est en légère baisse depuis les années 2010, même si elles demeurent légèrement majoritaires. En 2023, les femmes représentent 51 % des personnes immigrées arrivées en France, contre 53 % en 2006.
Les nouveaux arrivants sont de plus en plus qualifiés : 52 % des personnes immigrées entrées sur le territoire en 2023 et âgées de 25 ans ou plus étaient diplômées du supérieur, contre 41 % en 2006.
- Des entrées sur le territoire en hausse jusqu’en 2019 puis heurtées par la crise sanitaire et la guerre en Ukraine
- Le premier continent d’origine des immigrés récemment arrivés était l’Europe en 2006, l’Afrique en 2023
- Les entrées d’immigrés nés en Afrique augmentent, de façon plus marquée pour les pays autres que ceux du Maghreb
- Le Maroc et l’Algérie demeurent chaque année parmi les trois principaux pays d’origine des immigrés arrivant en France
- La part des femmes parmi les nouveaux immigrés diminue, et dépasse à peine 50 %
- Les immigrés récemment arrivés en France sont de plus en plus diplômés
- Les taux d’emploi peu après leur arrivée des femmes et des hommes immigrés se rapprochent entre 2006 et 2023

Avertissement : La méthode d’estimation des entrées sur le territoire a été revue par rapport aux années précédentes (méthodes) et les séries révisées sur la période 2006-2023. Cette évolution affecte également les estimations du nombre de sorties du territoire. En revanche, le solde migratoire et le nombre d’immigrés vivant en France chaque année sont inchangés.
Des entrées sur le territoire en hausse jusqu’en 2019 puis heurtées par la crise sanitaire et la guerre en Ukraine
En 2023, 347 000 personnes immigrées sont arrivées en France pour une durée d’au moins un an, contre 234 000 en 2006 (figure 1). Sur cette période, les entrées de personnes immigrées ont régulièrement augmenté jusqu’en 2019, soit avant la crise sanitaire : en moyenne par an, elles ont été de 234 000 entre 2006 et 2009, de 264 000 entre 2010 et 2014 et de 294 000 entre 2015 et 2019.
tableauFigure 1 - Nombre de personnes immigrées entrées en France par année d'arrivée
| Année | Nombre d'entrées de personnes immigrées en France |
|---|---|
| 2006 | 234 |
| 2007 | 230 |
| 2008 | 235 |
| 2009 | 238 |
| 2010 | 251 |
| 2011 | 255 |
| 2012 | 278 |
| 2013 | 277 |
| 2014 | 259 |
| 2015 | 278 |
| 2016 | 287 |
| 2017 | 291 |
| 2018 | 306 |
| 2019 | 307 |
| 2020 | 246 |
| 2021 | 283 |
| 2022 | 375 |
| 2023 | 347 |
- Lecture : En 2023, 347 000 personnes immigrées sont entrées en France.
- Champ : Personnes immigrées entrées en France hors Mayotte jusqu'en 2013 et y compris Mayotte à partir de 2014.
- Source : Insee, enquêtes annuelles de recensement 2007-2024.
graphiqueFigure 1 - Nombre de personnes immigrées entrées en France par année d'arrivée

- Lecture : En 2023, 347 000 personnes immigrées sont entrées en France.
- Champ : Personnes immigrées entrées en France hors Mayotte jusqu'en 2013 et y compris Mayotte à partir de 2014.
- Source : Insee, enquêtes annuelles de recensement 2007-2024.
Le début des années 2020 est marqué par deux chocs ayant des effets marqués sur le nombre d’entrées d’immigrés. Tout d’abord, la crise sanitaire de 2020 se traduit par une baisse ponctuelle des entrées d’immigrés entre 2019 (307 000) et 2020 (246 000). En 2021, dans un contexte de poursuite des restrictions des déplacements dans le monde, les arrivées demeurent à un niveau faible (283 000) par rapport à la tendance des années précédant la crise sanitaire. Puis, en 2022, un effet de rattrapage après la crise sanitaire et le début de la guerre en Ukraine conduisent à une forte hausse des entrées d’immigrés. Celles-ci atteignent ainsi en 2022 leur plus haut niveau depuis le début des mesures (375 000), sous l’effet notamment d’arrivées nombreuses de personnes immigrées nées en Ukraine ou en Russie [Tanneau, 2024].
Le premier continent d’origine des immigrés récemment arrivés était l’Europe en 2006, l’Afrique en 2023
Parmi les immigrés arrivés en France en 2006, 103 000 sont nés en Europe, 72 000 en Afrique, 33 000 en Asie et 27 000 en Amérique ou Océanie (figure 2). L’Europe est alors le premier continent d’origine des personnes immigrées arrivant en France. Parmi les immigrés arrivés en 2023, 158 000 sont nés en Afrique, soit davantage que ceux nés en Europe, qui sont 95 000. Les entrées en provenance d’Asie demeurent moins nombreuses (63 000) mais elles ont presque doublé depuis 2006.
tableauFigure 2 - Nombre de personnes immigrées entrées en France par année d'arrivée et origine
| Origines | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Afrique | 72 | 70 | 72 | 79 | 81 | 81 | 87 | 87 | 93 | 102 | 104 | 109 | 121 | 129 | 103 | 121 | 134 | 158 |
| Maghreb | 42 | 42 | 44 | 43 | 45 | 47 | 48 | 50 | 51 | 56 | 53 | 57 | 63 | 66 | 52 | 59 | 65 | 72 |
| Autres pays d'Afrique | 30 | 29 | 28 | 36 | 35 | 34 | 39 | 37 | 42 | 47 | 50 | 53 | 58 | 63 | 51 | 62 | 69 | 86 |
| Asie | 33 | 36 | 33 | 36 | 34 | 35 | 37 | 36 | 36 | 40 | 45 | 47 | 49 | 46 | 37 | 48 | 59 | 63 |
| Turquie, Moyen-Orient | 12 | 11 | 10 | 10 | 8 | 9 | 8 | 9 | 10 | 13 | 14 | 15 | 18 | 13 | 10 | 17 | 20 | 19 |
| Autres pays d'Asie | 21 | 24 | 24 | 26 | 26 | 26 | 28 | 27 | 26 | 28 | 31 | 32 | 31 | 34 | 27 | 31 | 39 | 43 |
| Europe | 103 | 101 | 103 | 98 | 106 | 113 | 128 | 128 | 107 | 109 | 108 | 103 | 106 | 99 | 79 | 86 | 148 | 95 |
| Europe du Sud | 25 | 26 | 28 | 25 | 29 | 38 | 47 | 49 | 40 | 37 | 38 | 32 | 33 | 31 | 25 | 28 | 29 | 25 |
| Autres pays de l'UE27 | 41 | 39 | 40 | 38 | 41 | 43 | 44 | 42 | 37 | 41 | 36 | 34 | 37 | 34 | 27 | 32 | 39 | 34 |
| Autres pays d'Europe | 36 | 36 | 34 | 35 | 36 | 32 | 37 | 38 | 29 | 32 | 34 | 37 | 37 | 34 | 27 | 26 | 80 | 37 |
| Amérique, Océanie | 27 | 24 | 27 | 25 | 31 | 26 | 26 | 26 | 24 | 27 | 31 | 32 | 29 | 33 | 26 | 27 | 33 | 31 |
| Ensemble des immigrés | 234 | 230 | 235 | 238 | 251 | 255 | 278 | 277 | 259 | 278 | 287 | 291 | 306 | 307 | 246 | 283 | 375 | 347 |
- Note : Ouvrir dans un nouvel ongletLes pays d'Europe du Sud sont l'Espagne, l'Italie et le Portugal.
- Lecture : En 2023, 158 000 personnes immigrées nées en Afrique sont entrées en France.
- Champ : Personnes immigrées entrées en France hors Mayotte jusqu'en 2013 et y compris Mayotte à partir de 2014.
- Source : Insee, enquêtes annuelles de recensement 2007-2024.
graphiqueFigure 2 - Nombre de personnes immigrées entrées en France par année d'arrivée et origine

- Lecture : En 2023, 158 000 personnes immigrées nées en Afrique sont entrées en France.
- Champ : Personnes immigrées entrées en France hors Mayotte jusqu'en 2013 et y compris Mayotte à partir de 2014.
- Source : Insee, enquêtes annuelles de recensement 2007-2024.
Le nombre d’entrées de personnes immigrées nées en Europe augmente fortement entre 2009 (98 000 entrées) et 2013 (128 000), notamment sous l’effet de la crise économique à partir de 2008 qui pousse de nombreux Européens du Sud (Espagne, Italie, Portugal) à aller chercher des opportunités en dehors de leur pays d’origine et conduit à un doublement de leurs arrivées annuelles en France. Entre 2009 et 2013, les pays d’Europe du Sud concentrent l’essentiel de l’augmentation des entrées des immigrés nés en Europe : sur cette période, les arrivées d’immigrés d’Europe augmentent de 30 000 personnes, dont 24 000 pour les seuls pays d’Europe du Sud. Après 2013, les entrées de personnes immigrées nées en Europe baissent tendanciellement jusqu’en 2020. L’année 2022, marquée par le début de la guerre en Ukraine, se traduit par un pic d’arrivées d’immigrés nés dans des pays européens n’appartenant pas à l’Union européenne (UE).
Les entrées d’immigrés nés en Afrique augmentent, de façon plus marquée pour les pays autres que ceux du Maghreb
Depuis 2006, le nombre de personnes nées sur le continent africain arrivant chaque année en France augmente de façon continue, exception faite des années de crise sanitaire. Les entrées d’immigrés en provenance d’Afrique dépassent en 2017 les arrivées de ceux originaires d’Europe. Si cette hausse du nombre d’entrées concerne aussi bien les personnes nées dans les pays du Maghreb que dans les autres pays d’Afrique, elle a été plus rapide pour les pays d’Afrique hors Maghreb, surtout à partir de la deuxième moitié des années 2010. Parmi les personnes immigrées nées en Afrique et arrivées en France en 2023, 54 % sont originaires d’un pays d’Afrique hors Maghreb ; elles étaient 42 % en 2006.
Enfin, alors que le nombre de personnes nées en Asie venant chaque année en France fluctuait légèrement aux alentours de 35 000 jusqu’au début des années 2010, il augmente à partir de 2015 pour atteindre 63 000 en 2023. Depuis 2013, le nombre d’entrées de personnes nées en Turquie ou au Moyen-Orient augmente particulièrement, en lien avec les crises et conflits que connaissent certains pays du Moyen-Orient dans cette décennie, comme la Syrie à partir de 2011 ou le Liban depuis 2021. La hausse des entrées de personnes nées dans un pays asiatique autre que la Turquie et les pays du Moyen-Orient est, elle, davantage continue depuis 2006.
Le Maroc et l’Algérie demeurent chaque année parmi les trois principaux pays d’origine des immigrés arrivant en France
Conséquence de ces évolutions, la part des immigrés nés en Europe parmi l’ensemble des immigrés entrés en France diminue fortement entre 2006 (44 %) et 2023 (28 %) (figure 3). À l’inverse, la part des immigrés nés dans des pays d’Afrique hors Maghreb augmente nettement (13 % en 2006, contre 25 % en 2023), tandis que les parts d’immigrés nés en Asie (14 % en 2006, contre 18 % en 2023) ou au Maghreb (18 % en 2006, contre 21 % en 2023) croissent plus modérément. Sur cette période, la part des immigrés nés en Amérique ou en Océanie parmi l’ensemble des entrants oscille autour de 10 %.
tableauFigure 3 - Origines des personnes immigrées entrées en France par année d'arrivée
| Origines | 2006 | 2010 | 2014 | 2018 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|
| Afrique | 31 | 32 | 36 | 40 | 45 |
| Maghreb | 18 | 18 | 20 | 21 | 21 |
| Autres pays d'Afrique | 13 | 14 | 16 | 19 | 25 |
| Asie | 14 | 14 | 14 | 16 | 18 |
| Turquie, Moyen-Orient | 5 | 3 | 4 | 6 | 6 |
| Autres pays d'Asie | 9 | 11 | 10 | 10 | 13 |
| Europe | 44 | 42 | 41 | 35 | 28 |
| Europe du Sud | 11 | 11 | 16 | 11 | 7 |
| Autres pays de l'UE27 | 18 | 16 | 14 | 12 | 10 |
| Autres pays d'Europe | 16 | 14 | 11 | 12 | 11 |
| Amérique, Océanie | 11 | 12 | 9 | 10 | 9 |
- Note : Ouvrir dans un nouvel ongletLes pays d'Europe du Sud sont l'Espagne, l'Italie et le Portugal.
- Lecture : 31 % des personnes immigrées entrées en France en 2006 sont nées dans un pays d'Afrique.
- Champ : Personnes immigrées entrées en France hors Mayotte jusqu'en 2013 et y compris Mayotte à partir de 2014.
- Source : Insee, enquêtes annuelles de recensement 2007-2024.
Tout au long de la période, les pays du Maghreb et d’Europe du Sud restent parmi les premiers pays d’origine des immigrés entrants en France. Chaque année, le Maroc et l’Algérie figurent parmi les trois premiers pays d’origine des nouveaux immigrés, avec en moyenne 15 % des entrées concernant des personnes nées dans l’un ou l’autre de ces deux pays. Malgré la baisse de la part d’immigrés d’Europe du Sud dans l’ensemble des entrées d’immigrés (11 % en 2006, contre 7 % en 2023), au moins l’un des trois pays de cette région (Portugal, Espagne et Italie) fait partie, chaque année entre 2006 et 2022, des cinq premiers pays d’origine des immigrés nouvellement arrivés.
La part des femmes parmi les nouveaux immigrés diminue, et dépasse à peine 50 %
Un peu plus de la moitié des personnes immigrées arrivées en France chaque année sont des femmes mais cette part baisse, particulièrement depuis le milieu des années 2010. Ainsi, alors qu’elles représentaient 53 % des personnes immigrées arrivées en France entre 2006 et 2014, elles ne sont plus que 51 % en 2023 (figure 4).
tableauFigure 4 - Part de femmes parmi les personnes immigrées entrées en France, selon l'année d'arrivée
| Origines | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Afrique | 54 | 54 | 53 | 51 | 52 | 52 | 53 | 54 | 52 | 52 | 50 | 51 | 49 | 50 | 50 | 50 | 50 | 51 |
| Maghreb | 55 | 55 | 53 | 52 | 54 | 52 | 53 | 56 | 55 | 56 | 55 | 55 | 54 | 54 | 53 | 53 | 52 | 54 |
| Autres pays d'Afrique | 52 | 53 | 54 | 50 | 50 | 51 | 52 | 51 | 50 | 47 | 45 | 47 | 44 | 47 | 47 | 47 | 49 | 48 |
| Asie | 56 | 58 | 57 | 58 | 55 | 56 | 59 | 55 | 54 | 54 | 51 | 51 | 49 | 51 | 50 | 44 | 47 | 50 |
| Turquie, Moyen-Orient | 48 | 51 | 52 | 49 | 53 | 51 | 54 | 46 | 48 | 47 | 48 | 48 | 46 | 46 | 47 | 47 | 46 | 49 |
| Autres pays d'Asie | 61 | 61 | 59 | 61 | 56 | 58 | 60 | 59 | 57 | 57 | 53 | 53 | 50 | 52 | 52 | 43 | 47 | 50 |
| Europe | 51 | 52 | 51 | 52 | 51 | 51 | 51 | 51 | 52 | 50 | 50 | 51 | 51 | 50 | 50 | 50 | 55 | 51 |
| Europe du Sud | 47 | 48 | 48 | 50 | 47 | 49 | 48 | 48 | 50 | 48 | 47 | 49 | 50 | 46 | 46 | 51 | 48 | 49 |
| Autres pays de l'UE27 | 52 | 52 | 52 | 52 | 52 | 51 | 52 | 53 | 53 | 51 | 51 | 52 | 52 | 51 | 51 | 49 | 52 | 51 |
| Autres pays d'Europe | 53 | 53 | 52 | 54 | 54 | 52 | 53 | 52 | 55 | 52 | 52 | 52 | 52 | 53 | 53 | 52 | 60 | 53 |
| Amérique, Océanie | 55 | 55 | 51 | 57 | 58 | 58 | 55 | 54 | 56 | 56 | 57 | 54 | 54 | 55 | 55 | 54 | 55 | 57 |
| Ensemble des immigrés | 53 | 54 | 52 | 53 | 53 | 52 | 53 | 53 | 53 | 52 | 51 | 51 | 50 | 51 | 51 | 50 | 52 | 51 |
- Note : Ouvrir dans un nouvel ongletLes pays d'Europe du Sud sont l'Espagne, l'Italie et le Portugal.
- Lecture : En 2023, 51 % des personnes immigrées entrées en France sont des femmes.
- Champ : Personnes immigrées entrées en France hors Mayotte jusqu'en 2013 et y compris Mayotte à partir de 2014.
- Source : Insee, enquêtes annuelles de recensement 2007-2024.
graphiqueFigure 4 - Part de femmes parmi les personnes immigrées entrées en France, selon l'année d'arrivée

- Lecture : En 2023, 51 % des personnes immigrées entrées en France sont des femmes.
- Champ : Personnes immigrées entrées en France hors Mayotte jusqu'en 2013 et y compris Mayotte à partir de 2014.
- Source : Insee, enquêtes annuelles de recensement 2007-2024.
Jusqu’au milieu des années 1970, les nouveaux immigrés étaient majoritairement des hommes, dans un contexte de besoin de main-d’œuvre. Ensuite, l’immigration de travail a été ralentie et l’immigration en France est devenue majoritairement féminine en raison tout d’abord de migrations familiales. La féminisation des migrations s'explique également par le rapprochement des motifs de migration des femmes et des hommes : au fil du temps, les femmes migrent de plus en plus de façon autonome afin de travailler ou de faire des études [Ouvrir dans un nouvel ongletBeauchemin et al., 2013].
Deux phénomènes concourent à la baisse de la part des femmes parmi l’ensemble des immigrés récents. D’une part, les arrivées en provenance de certains pays sont moins féminisées qu’auparavant : par exemple, 55 % des personnes immigrées nouvellement entrées en France et nées en Turquie étaient des femmes en 2012, contre 46 % en 2023. D’autre part, les pays d’origine se renouvellent et certains d’entre eux, à l’immigration majoritairement masculine, prennent une part croissante dans les entrées. C’est le cas de l’Afghanistan, dont les entrées ont été multipliées par 25 entre 2010 et 2023, mais aussi de pays d’Asie du Sud, notamment le Bangladesh, l’Inde ou le Pakistan. En 2023, le nombre d’entrées d’immigrés originaires de chacun de ces quatre pays dépasse celui des immigrés nés dans des pays d’immigration plus ancienne et plus féminine, comme le Japon ou le Vietnam. En conséquence, la part de femmes parmi les nouveaux immigrés venant d’Asie baisse sensiblement entre 2012 (59 %) et 2023 (50 %). Cette baisse concerne à la fois la Turquie et le Moyen-Orient (54 % de femmes parmi les entrées en 2012, contre 49 % en 2023), mais surtout les pays d’Asie hors Turquie et Moyen-Orient (60 % en 2012, contre 50 % en 2023).
Parmi les personnes immigrées nées en Afrique, la part de femmes baisse de manière moins prononcée : 54 % des personnes immigrées nées en Afrique et entrées en France en 2013 étaient des femmes, contre 51 % en 2023. Cette baisse concerne avant tout les pays d’Afrique hors Maghreb (51 % de femmes parmi les entrées en 2013, contre 48 % en 2023), et dans une moindre mesure les pays du Maghreb (56 % de femmes parmi les entrées en 2013, contre 54 % en 2023). À nouveau, plusieurs pays aux immigrations majoritairement masculines contribuent significativement à cette recomposition, comme la Guinée, le Soudan ou le Mali.
Parmi les personnes immigrées nées en Europe, la part des femmes augmente fortement en 2022 (55 % de femmes parmi les entrées en 2022) avant de retrouver en 2023 un niveau identique aux années précédentes (51 % de femmes en 2023 ainsi qu’en moyenne entre 2006 et 2021). Cette augmentation en 2022 s’explique par l’arrivée en France de nombreuses personnes immigrées nées en Ukraine, dont près des deux tiers sont des femmes [Tanneau, 2024].
Les immigrés récemment arrivés en France sont de plus en plus diplômés
Le niveau de diplôme des nouveaux immigrés augmente entre 2006 et 2023. 52 % des immigrés d’au moins 25 ans entrés en France en 2023 sont diplômés de l’enseignement supérieur, contre 41 % en 2006 (figure 5). À l’inverse, 22 % des personnes immigrées arrivées en France en 2023 et âgées d’au moins 25 ans sont sans diplôme, contre 30 % en 2006.
tableauFigure 5 - Part des personnes immigrées entrées en France par diplôme, selon l'année d'arrivée
| Niveau de diplôme | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aucun diplôme | 30 | 30 | 29 | 28 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 24 | 27 | 25 | 24 | 24 | 24 | 25 | 22 | 22 |
| Brevet des collèges, CAP ou BEP | 11 | 11 | 11 | 10 | 10 | 11 | 11 | 11 | 11 | 13 | 13 | 12 | 13 | 12 | 12 | 11 | 11 | 11 |
| Baccalauréat ou équivalent | 17 | 18 | 17 | 17 | 17 | 17 | 19 | 18 | 14 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 16 | 14 | 14 | 15 |
| Diplômé du supérieur | 41 | 42 | 43 | 45 | 47 | 45 | 43 | 43 | 44 | 48 | 46 | 47 | 49 | 48 | 48 | 50 | 52 | 52 |
- Lecture : En 2023, 52 % des personnes immigrées entrées en France sont diplômées du supérieur, 22 % n'ont aucun diplôme.
- Champ : Personnes immigrées entrées en France, hors Mayotte jusqu'en 2013 et y compris Mayotte à partir de 2014, âgées d'au moins 25 ans.
- Source : Insee, enquêtes annuelles de recensement 2007-2024.
graphiqueFigure 5 - Part des personnes immigrées entrées en France par diplôme, selon l'année d'arrivée

- Lecture : En 2023, 52 % des personnes immigrées entrées en France sont diplômées du supérieur, 22 % n'ont aucun diplôme.
- Champ : Personnes immigrées entrées en France, hors Mayotte jusqu'en 2013 et y compris Mayotte à partir de 2014, âgées d'au moins 25 ans.
- Source : Insee, enquêtes annuelles de recensement 2007-2024.
Cette hausse du niveau de diplôme concerne toutes les origines à l’exception de l’Asie, notamment car il s’agit depuis longtemps d’une immigration particulièrement diplômée. En 2006, près d’une personne immigrée née en Asie sur deux (48 %) âgée d’au moins 25 ans et entrée sur le territoire cette même année est diplômée du supérieur. Cette part augmente jusqu’en 2015 et atteint alors 59 %, puis diminue depuis lors pour rejoindre en 2023 un niveau proche de 50 %. Cette baisse depuis 2015 s’observe uniquement parmi les entrants nés dans un pays d’Asie hors Turquie et Moyen-Orient, et pourrait s’expliquer par le renouvellement des pays d’origine et des motifs de migration.
L’Afrique est le continent connaissant la plus forte augmentation de la part d’immigrés récents diplômés de l’enseignement supérieur. Ainsi, une personne immigrée sur deux née en Afrique et arrivée en France en 2023 possède un diplôme du supérieur, contre un peu moins d’une personne sur trois en 2006. Les pays du Maghreb sont ceux qui enregistrent la plus forte progression de la part des diplômés du supérieur (+25 points entre les immigrés entrés en France en 2006 et ceux arrivés en 2023).
Si le niveau de diplôme des nouveaux immigrés augmente de façon tendancielle, les périodes de crise économique peuvent être marquées par une augmentation ponctuelle de la part des immigrés non diplômés parmi les entrants. Ainsi, 26 % des personnes immigrées entrées sur le territoire en 2010 et âgées d’au moins 25 ans n’ont pas de diplôme, contre 30 % en 2014. Cette hausse entre 2010 et 2014 de la part de personnes non diplômées parmi les nouveaux immigrés est particulièrement marquée pour ceux originaires de pays de l’UE (+6 points).
Les taux d’emploi peu après leur arrivée des femmes et des hommes immigrés se rapprochent entre 2006 et 2023
La part de nouveaux immigrés en emploi l’année qui suit leur arrivée est globalement stable entre 2006 et 2023 : en moyenne, un nouvel immigré sur trois âgé d’au moins 15 ans est en emploi au début de l’année qui suit son arrivée en France. La part des personnes immigrées occupant un emploi augmente ensuite avec leur durée de présence sur le territoire, notamment du fait d’une meilleure connaissance de la langue et du marché du travail français, de la fin de leurs études, ou encore en raison de la constitution d’un réseau professionnel [Giorgi, Le Thi, 2023].
Toutefois, le ralentissement de la croissance économique dans la décennie 2010 s’est traduit par une baisse du taux d’emploi des nouveaux immigrés et une hausse de leur taux de chômage. Toutes origines confondues, le taux d’emploi des immigrés entrés en 2015 était de 29 % début 2016, soit le taux le plus bas observé sur la période. Cette baisse du taux d’emploi jusqu’au milieu des années 2010 a concerné les immigrés de tous les continents, mais plus particulièrement ceux venant d’Amérique et d’Océanie, dans un contexte également marqué par un renouvellement des pays d’origine, notamment par une forte augmentation du nombre d’entrées de personnes nées en Haïti à partir de 2016. Pour les autres continents, la diminution du taux d’emploi a surtout concerné les personnes nées en Turquie ou au Moyen-Orient (-11 points entre 2010 et 2015) et en Afrique hors Maghreb (-5 points). Le taux d’emploi des nouveaux immigrés est ensuite remonté à partir du milieu des années 2010 pour atteindre 34 % à 35 % entre 2021 et 2023. Cette hausse concerne tous les continents, mais est particulièrement marquée pour les personnes nées en Amérique ou en Océanie (+15 points entre 2016 et 2023) ainsi qu’en Afrique (+9 points).
La part de personnes immigrées occupant un emploi peu après leur arrivée en France est bien plus élevée pour les hommes que pour les femmes : parmi les immigrés entrés en France en 2023, 41 % des hommes et 28 % des femmes étaient en emploi au début de l’année suivant leur arrivée, soit un écart de 13 points. Toutefois, cet écart se réduit tendanciellement : il était de 20 points en 2006, et diminue progressivement pour atteindre 13 points pour les immigrés entrés en France depuis 2021.
Sources
Le recensement de la population permet de connaître le nombre de personnes résidant en France et leur profil. Il comptabilise uniquement les personnes installées en France depuis douze mois ou plus ou qui comptent s’y installer pour douze mois ou plus. Ainsi, les étudiants qui poursuivent une année de scolarité de septembre à juillet, les travailleurs venus pour un contrat de moins de douze mois ou encore les personnes ne vivant qu’une partie de l’année en France ne sont pas recensés. En revanche, le recensement comptabilise toutes les personnes résidant en France indépendamment de leur situation administrative, y compris les personnes en situation irrégulière, sans les identifier en tant que telles. Chaque recensement est issu du cumul de cinq enquêtes annuelles de recensement.
Méthodes
Les entrées sur le territoire français sont estimées à partir des enquêtes annuelles de recensement (EAR) [Brutel, 2014]. Le nombre d’entrées sur toute la période a été révisé par rapport aux précédentes publications, en raison d’améliorations méthodologiques du traitement de la réponse partielle au bulletin individuel du recensement [Barrau, Tanneau, 2025]. Le recensement à Mayotte suit jusqu’en 2021 une méthodologie et une temporalité différente du reste du territoire : le calcul des entrées dans ce département jusqu’en 2023 s’appuie sur la comparaison des deux derniers recensements exhaustifs menés en 2012 et en 2017.
Les entrées sur le territoire ne sont que l’un des éléments permettant d’expliquer l’évolution de la population immigrée en France, qui varie également en raison des décès et sorties du territoire [Rouhban, Tanneau, 2024].
Définitions
Un immigré est une personne née étrangère à l'étranger et résidant en France. L’origine d’un immigré est déterminée par son pays de naissance. Certains immigrés ont pu devenir Français, les autres restant étrangers. Un individu continue à être immigré même s'il acquiert la nationalité française.
Pour en savoir plus
Retrouvez plus de données en téléchargement.
Barrau A., Tanneau P., « Rénovation de la méthodologie d’estimation des entrées en France », Documents de travail no 2025-11, mai 2025.
Tanneau P., « Flux migratoires – Des entrées en hausse en 2022 dans un contexte de normalisation sanitaire et de guerre en Ukraine », Insee Première no 1991, avril 2024.
Rouhban O., Tanneau, P., « Population immigrée, entrées sur le territoire, titres de séjour… S’y retrouver dans les chiffres de l’immigration », Le blog de l’Insee, avril 2024.
Giorgi J., Le Thi C., « L’insertion professionnelle des immigrés primo‑arrivants en France », in Immigrés et descendants d’immigrés en France, coll. « Insee Références », édition 2023.
Brutel C., « Estimer les flux d’entrées sur le territoire à partir des enquêtes annuelles de recensement », Documents de travail no F1403, mai 2014.
Beauchemin C., Borrel C., Régnard C., « Ouvrir dans un nouvel ongletLes immigrés en France : en majorité des femmes », Population et Sociétés no 502, Ined, août 2013.



