 Insee Première ·
Septembre 2025 · n° 2069
Insee Première ·
Septembre 2025 · n° 2069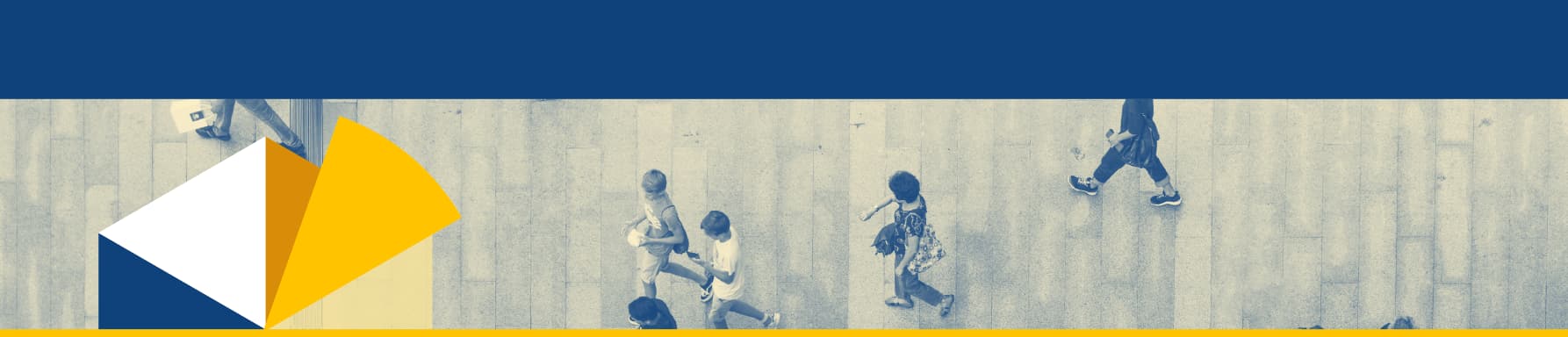 Micro‑entrepreneurs immatriculés en 2018 : moins de trois sur dix encore actifs cinq ans
après
Micro‑entrepreneurs immatriculés en 2018 : moins de trois sur dix encore actifs cinq ans
après
28 % des micro‑entrepreneurs s’étant immatriculés en 2018 sont encore actifs cinq ans après leur immatriculation. En effet, parmi les 70 % ayant effectivement démarré leur activité au cours des deux premières années, 39 % sont pérennes à cinq ans. La pérennité est la plus forte dans les secteurs de la santé humaine et de l’industrie et la plus faible dans le conseil de gestion, le commerce et la livraison. Les chances de pérennité augmentent avec l’âge du micro-entrepreneur et les moyens qu’il a investis au démarrage. 34 % des femmes sont encore actives sous ce régime cinq ans après, soit 10 points de plus que les hommes.
Le chiffre d’affaires moyen des micro‑entrepreneurs encore actifs en 2023 s’établit à 20 000 euros. La crise sanitaire n’a pas eu d’impact net sur la pérennité des micro‑entrepreneurs de cette cohorte. En revanche, elle en a eu sur leur chiffre d’affaires qui a baissé, durant cette période, pour deux tiers de ceux encore actifs fin 2021.
9 % des micro‑entrepreneurs encore actifs en 2023 travaillent via les plateformes numériques de mise en relation, contre 14 % l’année de leur immatriculation.
- 28 % des micro-entrepreneurs encore actifs cinq ans après
- Très faible pérennité dans le secteur de la livraison
- La pérennité varie avec l’âge et le sexe du micro‑entrepreneur
- Expérience et investissement initial favorisent la pérennité
- Les projets bénéficiant de soutien sont plus souvent pérennes
- Un chiffre d’affaires moyen de 20 000 euros en 2023
- La crise sanitaire a plus affecté les chiffres d’affaires que la pérennité
- Moins de collaboration avec les plateformes numériques au fil du temps
28 % des micro-entrepreneurs encore actifs cinq ans après
En 2018, 750 000 entreprises ont été créées en France, dont 399 000 sous le régime du micro‑entrepreneur, soit 53 % des créations. 70 % des micro‑entrepreneurs qui se sont immatriculés au premier semestre 2018 ont démarré leur activité, c’est-à-dire déclaré au moins un chiffre d’affaires non nul durant les huit trimestres suivant l’immatriculation. Parmi eux, 39 % sont pérennes à cinq ans, c’est-à-dire encore actifs sous ce régime cinq ans après leur immatriculation (figure 1). Ainsi, 28 % des micro‑entrepreneurs immatriculés au premier trimestre 2018 sont encore actifs sous ce régime à cinq ans. Les autres ont cessé leur activité, sauf une petite partie, de l’ordre de 3 à 5 %, qui a changé de statut juridique (société ou entrepreneur individuel « classique »). Le taux de pérennité à cinq ans des entreprises individuelles classiques de la même génération atteint 63 %, celui des sociétés 71 %. Les micro‑entrepreneurs ont donc une probabilité de survie nettement inférieure aux autres régimes.
tableauFigure 1 – Taux de pérennité de un à cinq ans des micro-entrepreneurs immatriculés en 2014 et 2018 et ayant démarré leur activité
| Type d’entreprise | Création | 1 an | 2 ans | 3 ans | 4 ans | 5 ans |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Micro‑entrepreneurs immatriculés en 2014 | 100,0 | 75,1 | 57,4 | 46,2 | 38,7 | 33,4 |
| Micro‑entrepreneurs immatriculés en 2018 | 100,0 | 82,6 | 64,9 | 54,0 | 46,0 | 39,3 |
| Entreprises individuelles créées en 2018, hors micro‑entrepreneurs | 100,0 | 87,2 | 78,6 | 73,8 | 68,0 | 63,3 |
- Note : Les données à un, deux et trois ans sont révisées par rapport aux précédentes publications.
- Lecture : 39,3 % des micro-entrepreneurs immatriculés au premier semestre 2018 et ayant démarré leur activité sont encore actifs sous ce régime cinq ans après leur création.
- Champ : France, entreprises individuelles et micro-entrepreneurs des secteurs marchands non agricoles, immatriculés au premier semestre 2018 et ayant effectivement démarré une activité.
- Source : Insee, enquêtes Sine 2014 (interrogations 2014 et 2019) et 2018 (interrogations 2018, 2021 et 2023), base Non‑salariés.
graphiqueFigure 1 – Taux de pérennité de un à cinq ans des micro-entrepreneurs immatriculés en 2014 et 2018 et ayant démarré leur activité

- Note : Les données à un, deux et trois ans sont révisées par rapport aux précédentes publications.
- Lecture : 39,3 % des micro-entrepreneurs immatriculés au premier semestre 2018 et ayant démarré leur activité sont encore actifs sous ce régime cinq ans après leur création.
- Champ : France, entreprises individuelles et micro-entrepreneurs des secteurs marchands non agricoles, immatriculés au premier semestre 2018 et ayant effectivement démarré une activité.
- Source : Insee, enquêtes Sine 2014 (interrogations 2014 et 2019) et 2018 (interrogations 2018, 2021 et 2023), base Non‑salariés.
Les taux de pérennité des micro‑entrepreneurs immatriculés en 2018 sont supérieurs à ceux de la cohorte 2014. Le taux de démarrage était alors de 66 %, dont 33 % de micro‑entrepreneurs pérennes à cinq ans, soit 22 % encore actifs sous ce régime cinq ans après leur immatriculation. La différence entre les deux cohortes se fait pour les trois quarts sur la première année. En 2018, les seuils maximaux de chiffre d’affaires des micro‑entrepreneurs ont doublé. Des projets plus ambitieux en matière de chiffre d’affaires et aux chances de pérennité plus fortes, qui se créaient sous un régime classique en 2014, ont ainsi vu le jour sous le régime de micro‑entrepreneur en 2018. 43 % des micro‑entrepreneurs de 2018 auraient créé une entreprise sous un autre régime si leur régime n’existait pas, contre 36 % en 2014. Cinq ans après l’immatriculation, ils sont globalement plus nombreux à être actifs que les autres (30 % contre 25 %).
Très faible pérennité dans le secteur de la livraison
Deux secteurs prépondérants sont peu pérennes : le commerce, avec une proportion d’actifs à cinq ans de 22 %, et le conseil pour les affaires et autres conseils de gestion avec 17 % (figure 2). Le commerce est également un secteur où les sociétés et les entreprises individuelles « classiques » sont moins pérennes. Les activités de livraison, qui réunissent principalement les livreurs à domicile de courrier, colis, courses et repas, ont la proportion d’actifs à cinq ans la plus faible : 6 %.
tableauFigure 2 – Démarrage et pérennité à cinq ans des micro-entrepreneurs immatriculés en 2018 par secteur d’activité
| Secteur d’activité | Répartition à l’immatriculation | Proportion d’actifs à cinq ans |
Taux de démarrage | Taux de pérennité à cinq ans des démarrés |
|---|---|---|---|---|
| Industrie | 4,5 | 43 | 83 | 52 |
| Construction | 9,4 | 36 | 80 | 45 |
| Commerce | 15,8 | 22 | 62 | 35 |
| Transports et entreposage, dont : | 11,9 | 8 | 49 | 17 |
| Livraison | 9,6 | 6 | 46 | 14 |
| Hébergement-restauration | 3,4 | 24 | 68 | 35 |
| Information et communication | 4,9 | 27 | 72 | 37 |
| Activités financières et d’assurance | 0,7 | 22 | 65 | 34 |
| Activités immobilières | 2,4 | 25 | 64 | 39 |
| Activités spécialisées, scientifiques et techniques, dont : | 18,9 | 23 | 70 | 32 |
| Conseil pour les affaires et la gestion hors relations publiques et communication | 9,2 | 17 | 64 | 26 |
| Activités de services administratifs et de soutien | 6,5 | 33 | 74 | 45 |
| Enseignement | 5,6 | 36 | 80 | 45 |
| Santé humaine et action sociale, dont : | 4,2 | 46 | 82 | 56 |
| Santé humaine | 3,6 | 50 | 85 | 58 |
| Arts, spectacles et activités récréatives | 4,1 | 32 | 73 | 44 |
| Autres activités de services aux ménages | 7,6 | 41 | 80 | 52 |
| Ensemble | 100,0 | 28 | 70 | 39 |
- Lecture : L’industrie représente 4,5 % des immatriculations de micro-entrepreneurs en 2018. 43 % sont encore actifs sous ce régime cinq ans après leur immatriculation. En effet, parmi les 83 % ayant démarré leur activité, 52 % sont pérennes à cinq ans.
- Champ : France, micro-entrepreneurs des secteurs marchands non agricoles, immatriculés au premier semestre 2018.
- Source : Insee, enquête Sine 2018 (interrogations 2018 et 2023), base Non-salariés.
La proportion d’actifs à cinq ans culmine à 50 % dans le secteur de la santé humaine. L’industrie suit avec 43 %, puis les « autres activités de services aux ménages » à 41 %. Les autres secteurs plus pérennes que la moyenne sont la construction et l’enseignement, avec 36 % d’actifs cinq ans après l’immatriculation, les services administratifs et de soutien avec 33 % et les arts, spectacles et activités récréatives à 32 %.
Une analyse dite « toutes choses égales par ailleurs » corrobore cette hiérarchie sectorielle (méthodes). Elle confirme que le secteur d’activité est le facteur le plus déterminant des chances de pérennité, devant les caractéristiques sociodémographiques du micro‑entrepreneur et les autres caractéristiques du projet.
La pérennité varie avec l’âge et le sexe du micro‑entrepreneur
37 % des micro-entreprises immatriculées en 2018 ont été fondées par des femmes. 34 % de ces micro‑entrepreneuses sont actives à cinq ans, soit 10 points de plus que les micro‑entrepreneurs. Leur positionnement dans les secteurs où la pérennité est la plus élevée explique plus de la moitié de cet écart. Elles sont en effet plus nombreuses dans les secteurs de la santé humaine, des « autres activités de services aux ménages », de l’industrie et de l’enseignement. Toutefois, toutes choses égales par ailleurs, secteur d’activité compris, les micro‑entrepreneuses ont une probabilité d’être encore actives au bout de cinq ans, plutôt que de ne pas l’être, 1,2 fois plus élevée que les micro‑entrepreneurs.
Les chances de pérennité augmentent avec l’âge du micro‑entrepreneur à l’immatriculation jusqu'à 60 ans. La proportion d’actifs à cinq ans varie de 13 % chez les moins de 25 ans à 39 % pour les quinquagénaires. Elle baisse à 32 % pour les micro-entrepreneurs de 60 ans ou plus. Souvent retraités, ils cherchent avant tout à avoir un revenu de complément (51 %) ou à maintenir une activité (46 %). Dans cette tranche d’âge, le taux de démarrage est plus élevé (81 %), mais le taux de pérennité à cinq ans est dans la moyenne (40 %).
Expérience et investissement initial favorisent la pérennité
Pour 43 % des micro‑entrepreneurs, leur métier principal correspond à leur activité en tant que micro‑entrepreneur. Parmi eux, la proportion d’actifs à cinq ans est plus forte : 33 %, contre 23 % pour ceux dont le métier est différent. Cette proportion atteint même 38 % pour ceux ayant plus de dix ans d’expérience professionnelle dans le même domaine. En revanche, le niveau de diplôme n’a qu’une très faible influence sur la pérennité.
Mettre des moyens financiers au démarrage augmente les chances de pérennité à cinq ans. Parmi les 50 % de micro‑entrepreneurs avec un investissement initial nul, la proportion d’actifs à cinq ans est de 23 %. Elle passe à 28 % pour les 14 % de micro‑entrepreneurs ayant investi moins de 500 euros. Passé ce seuil, elle s’élève à environ 34 % quel que soit le montant investi.
Les projets bénéficiant de soutien sont plus souvent pérennes
Les micro‑entrepreneurs qui ont reçu un soutien, pécuniaire ou autre, ont des chances de pérennité de leur projet plus élevées que les autres. Recevoir un appui en matière de conseil, d’information ou de soutien logistique augmente la proportion d’actifs à cinq ans de 7 points et concerne 64 % des projets. Bénéficier de l’aide aux créateurs ou repreneurs d’entreprise augmente la proportion d’actifs à cinq ans de 6 points et concerne 44 % des projets. Le lien de cause à effet n’est pas établi : se faire conseiller ou aider peut être l’apanage des micro‑entrepreneurs mieux préparés et informés, qui auraient eu de toute façon de meilleures chances de pérennité.
23 % des micro‑entrepreneurs exercent une autre activité rémunérée à temps complet lorsqu’ils lancent leur projet, mais ils sont moins pérennes que les autres : 18 % d’entre eux sont actifs cinq ans après l’immatriculation. Pour eux, les projets sont plus souvent ponctuels : tests d’entreprise ou activités de complément qui ont moins vocation à être pérennes. Au contraire, 30 % de ceux qui n’ont pas d’autre emploi (65 % des micro‑entrepreneurs) ou qui exercent une autre activité rémunérée à temps partiel (12 %) sont actifs à cinq ans. Ceux pour qui le micro‑entrepreneuriat est l’unique activité rémunérée se sont immatriculés dans le but de créer leur propre emploi, ce qui favorise la pérennité.
Un chiffre d’affaires moyen de 20 000 euros en 2023
Le chiffre d’affaires moyen des micro‑entrepreneurs immatriculés au premier semestre 2018 et encore actifs fin 2023 s’établit à 20 000 euros en 2023 et le chiffre d’affaires médian à 12 000 euros (figure 3). La moitié des micro‑entrepreneurs ont un chiffre d’affaires compris entre 3 000 et 28 000 euros. Le ratio entre revenu d’activité et chiffre d’affaires est estimé à 53 % en moyenne, à partir des abattements représentatifs des frais professionnels réalisés par la DGFiP, soit un revenu annuel de 10 000 euros, équivalent à 60 % du SMIC net annuel. Les secteurs les plus lucratifs sont l’hébergement-restauration avec 29 000 euros de chiffre d’affaires moyen en 2023, la construction (28 000 euros) et les activités immobilières (26 000 euros). Les moins rémunérateurs sont les transports et l’entreposage (11 000 euros) et les services aux ménages dans leur ensemble (15 000 euros).
tableauFigure 3 – Distribution des chiffres d’affaires 2023 des micro-entrepreneurs immatriculés en 2018
| Distribution | Activité principale | Activité de complément | Ensemble |
|---|---|---|---|
| 1er décile1 | 1 842 | 290 | 750 |
| 1er quartile1 | 6 950 | 1 400 | 3 490 |
| Médiane1 | 18 790 | 5 075 | 12 348 |
| Moyenne | 24 950 | 10 739 | 19 571 |
| 3e quartile | 34 469 | 14 200 | 28 275 |
| 9e décile | 55 896 | 28 509 | 47 666 |
- 1. Définitions.
- Lecture : Le chiffre d’affaires médian des micro-entrepreneurs immatriculés en 2018 est de 12 348 euros en 2023. 10 % d’entre eux ont touché moins de 750 euros, 25 % moins de 3 490 euros.
- Champ : France hors Dom, micro-entrepreneurs des secteurs marchands non agricoles, immatriculés au premier semestre 2018 et encore actifs fin 2023.
- Source : Insee, enquête Sine 2018 (interrogations 2018 et 2023), base Non-salariés.
graphiqueFigure 3 – Distribution des chiffres d’affaires 2023 des micro-entrepreneurs immatriculés en 2018

- 1. Définitions.
- Lecture : Le chiffre d’affaires médian des micro-entrepreneurs immatriculés en 2018 est de 12 348 euros en 2023. 10 % d’entre eux ont touché moins de 750 euros, 25 % moins de 3 490 euros.
- Champ : France hors Dom, micro-entrepreneurs des secteurs marchands non agricoles, immatriculés au premier semestre 2018 et encore actifs fin 2023.
- Source : Insee, enquête Sine 2018 (interrogations 2018 et 2023), base Non-salariés.
Les 62 % de micro‑entrepreneurs encore actifs fin 2023 dont l’activité de micro‑entrepreneuriat est l’activité principale déclarent en moyenne 25 000 euros de chiffre d’affaires. 44 % d’entre eux ont une autre source de revenus, le plus fréquemment le revenu d’un conjoint (dans 44 % des cas) ou des prestations sociales ou indemnités (39 %). Les 38 % qui exercent en activité de complément déclarent en moyenne 11 000 euros de chiffre d’affaires. Pour 64 % d’entre eux, l’activité de micro‑entrepreneur est ponctuelle. Ils disposent d’une autre source de revenus, majoritairement un salaire (58 %) ou une pension de retraite (25 %). 61 % des micro‑entrepreneurs immatriculés en 2018 encore actifs fin 2023 sont satisfaits de leur chiffre d’affaires.
La crise sanitaire a plus affecté les chiffres d’affaires que la pérennité
Entre 2020 et 2022, pendant la crise sanitaire, la pérennité des projets de micro‑entrepreneurs n’a pas plus baissé que la pérennité entre 2016 et 2018 des projets démarrés en 2014. Les chiffres d’affaires ont quant à eux été affectés : 66 % des micro‑entrepreneurs de la cohorte 2018 encore actifs fin 2021 ont connu un chiffre d’affaires moindre qu’espéré en 2020 et 2021 à cause de la crise sanitaire, 9 % ont même perdu tout leur chiffre d’affaires. Le secteur de l’information et de la communication est le moins concerné : seuls 55 % des micro‑entrepreneurs de ce secteur ont vu leur chiffre d’affaires réduit par la crise. À l’opposé, 83 % de ceux du secteur des arts, spectacles et activités récréatives ont subi une baisse de chiffre d’affaires à cause de la crise sanitaire. Dans ce secteur, 21 % des micro‑entrepreneurs ont même temporairement arrêté leur activité durant cette période.
Les micro‑entrepreneurs qui connaissent une baisse de leur activité à cause de la crise déclarent souvent des difficultés financières, quel que soit le secteur (six sur dix en déclarent). Le manque de débouchés et de commandes en concernent quatre sur dix, notamment dans les secteurs de l’information et de la communication, des activités spécialisées, scientifiques et techniques et de l’industrie. Les difficultés d’approvisionnement en touchent un sur dix. Elles sont plus fréquentes dans la construction (quatre sur dix) et dans l’industrie et le commerce (deux sur dix). Les fermetures administratives liées aux mesures sanitaires en concernent un sur dix et elles sont sur-représentées dans les activités tournées vers les ménages, comme l’enseignement et les arts, spectacles et activités récréatives (deux sur dix).
La moitié des micro‑entrepreneurs de la cohorte 2018 encore actifs fin 2021 ont perçu des aides liées à la crise sanitaire, le plus souvent le fonds de solidarité pour indépendants (quatre sur dix). Moins d’un micro‑entrepreneur sur dix a profité d’un report des échéances fiscales et sociales. Les secteurs les plus aidés ont été l’hébergement-restauration et les « autres activités de services aux ménages ». La perception de ces aides n’a pas de conséquence significative sur la pérennité.
Moins de collaboration avec les plateformes numériques au fil du temps
Parmi les micro‑entrepreneurs immatriculés au premier semestre 2018 et encore actifs fin 2023, 9 % travaillent par l’intermédiaire d’une ou plusieurs plateformes numériques de mise en relation, soit 5 points de moins que l’année de leur immatriculation. Ils sont majoritaires dans la livraison, où 67 % d’entre eux utilisent de tels outils (contre 53 % fin 2018). Ils sont également surreprésentés dans l’hébergement-restauration (18 %) et dans l’édition et l’informatique (17 %). Les micro‑entrepreneurs ont tendance à se détacher des plateformes au fil du temps : 70 % de ceux qui les utilisaient comme principale source de chiffre d’affaires en 2018 ne travaillent plus avec en 2023. À l’inverse, seuls 7 % de ceux qui travaillaient sans en 2018 les utilisent cinq ans après. Le secteur de la livraison fait exception : 27 % des utilisateurs de ces plateformes les ont abandonnées, tandis que 56 % de ceux qui travaillaient sans en 2018 travaillent avec en 2023.
Parmi les micro‑entrepreneurs qui utilisent ces plateformes, 54 % le font pour gagner en visibilité et 48 % considèrent qu’il est difficile d’accéder aux marchés sans. 36 % déclarent que l’usage des plateformes permet d’accroître l’activité et 17 % que cela évite d’avoir à développer un site ou une application.
Sources
Le système d’information sur les nouvelles entreprises (Sine) – enquête micro‑entrepreneurs est un dispositif permanent d’observation d’une génération de nouvelles entreprises, tous les quatre ans. L’échantillon utilisé est composé de 56 000 micro‑entrepreneurs immatriculés au premier semestre 2018. Ils ont été enquêtés à trois reprises, fin 2018, fin 2021 et fin 2023. Seules les unités toujours actives économiquement ont été enquêtées pour la troisième vague. Le champ de l’enquête couvre 214 000 micro‑entrepreneurs immatriculés au premier semestre 2018 dans les activités marchandes non agricoles.
La nomenclature utilisée pour les enquêtes relatives à la génération 2018 est la NAF rév. 2. L’intitulé du poste « Autres activités de services » a été remplacé par « Autres activités de services aux ménages », plus explicite.
Le 1er janvier 2018, les plafonds de chiffre d’affaires permettant l’accès au régime fiscal de la micro-entreprise et du régime micro-social ont doublé. En 2018, année de création des entreprises de cette cohorte, le régime de micro-entrepreneur pouvait concerner des entreprises dont les chiffre d’affaires des deux années civiles précédentes n’excédaient pas chacun 170 000 euros pour une activité de vente de marchandises, d’objets, d’aliments à emporter ou à consommer sur place, ou de fourniture de logement, et 70 000 euros pour une activité de services. Depuis 2023, ils sont respectivement de 188 700 et 77 700 euros.
La base Non-salariés est issue de deux sources administratives, gérées par l’Urssaf Caisse nationale et par la caisse centrale de la Mutualité sociale agricole (CCMSA). Elle fournit les chiffres d’affaires déclarés par les cotisants, notamment les micro‑entrepreneurs.
Méthodes
Les facteurs influant sur la durée de vie des entreprises ne sont pas indépendants les uns des autres. La régression logistique permet de mesurer l’effet spécifique de chaque facteur sur la pérennité des entreprises, les autres facteurs pris en compte dans le modèle étant inchangés (« toutes choses égales par ailleurs »). Les coefficients, également appelés rapports de cotes ou odds ratio, correspondent au rapport des cotes de pérennité de la sous-population d’intérêt sur la sous-population de référence. La cote de pérennité c est égale au rapport de la probabilité p d’être pérenne à cinq ans sur la probabilité d’être cessée : c = p/(1–p). Plus l’odds ratio est supérieur à 1 (respectivement inférieur à 1), plus la probabilité d’atteindre le cinquième anniversaire est forte (respectivement faible) relativement à celle de cesser l’activité, par rapport à la situation de référence.
Du fait de la disponibilité de nouvelles données administratives, le taux de démarrage, les proportions d’actifs à un, deux et trois ans ainsi que les taux de pérennité à un, deux et trois ans ont été révisés à l’occasion de la publication des données de la troisième interrogation.
Définitions
Un micro-entrepreneur bénéficie du régime de même nom (appelé auto-entrepreneur jusqu’en 2014), qui offre des formalités de création d’entreprise allégées et un mode de calcul et de paiement simplifié des cotisations sociales et de l’impôt sur le revenu. Il s’applique aux entrepreneurs individuels qui en font la demande, sous certaines conditions.
Un micro-entrepreneur ayant démarré son activité économique est considéré comme l’ayant cessée à une date donnée quand il ne déclare plus de chiffre d’affaires positif à l’Urssaf Caisse nationale pendant huit trimestres consécutifs à compter de cette date. La cessation est estimée par un modèle pour une partie des unités, les données de l’Urssaf Caisse nationale ne permettant pas d’avoir un recul suffisant au moment de cette publication.
Le taux de pérennité à N ans est le rapport entre le nombre de micro-entrepreneurs immatriculés sur une période donnée encore actifs N années après leur immatriculation et l’ensemble des micro-entrepreneurs immatriculés sur cette même période ayant effectivement démarré leur activité.
Le taux de démarrage est le rapport entre le nombre de micro-entrepreneurs immatriculés sur une période donnée qui ont effectivement démarré leur activité économique et l’ensemble des micro-entrepreneurs immatriculés sur cette même période.
La proportion de micro-entrepreneurs actifs à N années est le rapport entre le nombre de micro-entrepreneurs immatriculés sur une période donnée encore actifs N années après leur immatriculation et l’ensemble des micro-entrepreneurs immatriculés sur cette même période (qu’ils aient démarré leur activité ou non).
L’aide aux créateurs ou repreneurs d’entreprise (ACRE, ACCRE avant 2021) se formalise par une exonération partielle des charges sociales sur les revenus du créateur pour les douze premiers mois de son activité, ou trois ans pour les micro-entrepreneurs.
Si on ordonne une distribution, les déciles sont les valeurs qui partagent cette distribution en dix parties d’effectifs égaux, les quartiles en quatre et la médiane en deux.
Pour en savoir plus
Retrouvez plus de données en téléchargement.
Baillot A., « Entreprises créées en 2018 : 69 % sont encore actives cinq ans après leur création », Insee Première no 2070, septembre 2025.
Morello E., « Entre 2014 et 2022, une augmentation de 42 % du nombre d’entreprises économiquement actives », Insee Première no 2045, avril 2025.
Becquet C., Richet D., « Les créateurs d’entreprise en 2022 – Huit créateurs d’entreprise sur dix fondent une entreprise pour la première fois », Insee Première no 2007, juillet 2024.
Richet D., Bignon N., « Micro‑entrepreneurs immatriculés en 2018 : dans les transports, deux sur trois travaillent via une plateforme numérique », Insee Première no 1821, octobre 2020.
Richet D., « Auto-entrepreneurs immatriculés en 2014 : trois ans après, 36 % sont actifs », Insee Première no 1765, juillet 2019.



