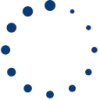Insee Flash Provence-Alpes-Côte d'Azur ·
Mars 2022 · n° 80
Insee Flash Provence-Alpes-Côte d'Azur ·
Mars 2022 · n° 80 Crise sanitaire : des conditions de vie plus dégradées pour les femmes
Crise sanitaire : des conditions de vie plus dégradées pour les femmes
En Provence-Alpes-Côte d’Azur comme en France, le surcroît de décès lié à l’épidémie de Covid-19 a été moins marqué pour les femmes que pour les hommes. Mais la crise sanitaire a eu des conséquences plus fortes sur les conditions de vie des femmes, aggravant pour certaines des situations déjà difficiles.
Les femmes sont majoritaires dans les métiers de « première ligne », qui ont maintenu leur activité sur leur lieu de travail lors du premier confinement. Par ailleurs, les mères de familles monoparentales, plus nombreuses en proportion dans la région, vivent plus fréquemment dans des logements suroccupés, ce qui a pu accentuer leurs difficultés durant les épisodes de confinement. Déjà élevées dans la région, les violences intrafamiliales subies par les femmes ont nettement augmenté en 2020, comme au niveau national.
- Un excédent de décès moindre pour les femmes que pour les hommes
- Les femmes très présentes parmi les métiers « de première ligne »
- Les femmes à la tête de famille monoparentale vivent plus souvent dans des logements trop petits
- Des violences intrafamiliales en hausse
- Encadré 1 – Un renoncement aux soins plus fréquent
- Encadré 2 – Une répartition des tâches plus inégalitaire pendant le premier confinement
- Encadré 3 – Partenariat
Un excédent de décès moindre pour les femmes que pour les hommes
Depuis mars 2020, la crise sanitaire liée à l’épidémie de Covid-19 influe sur le nombre total des décès (toutes causes confondues). Le nombre de décès de femmes a ainsi augmenté significativement (29 700 en 2021 et 28 600 en 2020, après 26 700 en 2019).
La hausse du nombre de décès par rapport à 2019 est toutefois moindre pour les femmes que pour les hommes, en particulier pour les plus âgés. Ainsi, entre 2019 et 2020, le nombre de décès a augmenté de 7,1 % chez les femmes et de 8,2 % chez les hommes (figure 1). Entre 2019 et 2021, la hausse est de 11,1 % pour les femmes et de 13,9 % pour les hommes. En 2021, l’excédent de décès par rapport à 2019 est plus marqué dans la région qu’au niveau national, ce qui n’était pas le cas en 2020, pour les femmes comme pour les hommes.
tableauFigure 1 – Excédent de décès en 2020 et 2021 par rapport à 2019, par sexe
| Femmes | Hommes | ||
|---|---|---|---|
| 2020 | Provence-Alpes-Côte d’Azur | 7,1 | 8,2 |
| France métropolitaine | 8,4 | 10,1 | |
| 2021 | Provence-Alpes-Côte d’Azur | 11,1 | 13,9 |
| France métropolitaine | 5,7 | 8,8 | |
- Lecture : entre 2019 et 2020, la hausse de décès des femmes en Provence-Alpes-Côte d’Azur est de 7,1 %. Entre 2019 et 2021, cette hausse est de 11,1 %.
- Source : Insee, état civil (au lieu de décès).
graphiqueFigure 1 – Excédent de décès en 2020 et 2021 par rapport à 2019, par sexe
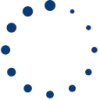
- Lecture : entre 2019 et 2020, la hausse de décès des femmes en Provence-Alpes-Côte d’Azur est de 7,1 %. Entre 2019 et 2021, cette hausse est de 11,1 %.
- Source : Insee, état civil (au lieu de décès).
Les différences de mortalité s’expliquent par de multiples facteurs, liés à la santé (comorbidités) mais aussi au contexte social. Les décès de femmes nées en France ont augmenté de 5,8 % entre 2019 et 2020 et la hausse est comparable pour les femmes nées en Italie ou en Espagne. Mais pour celles nées en Algérie, au Maroc et en Tunisie, le nombre de décès a augmenté beaucoup plus rapidement, entre 14 % à 15 % selon le pays. Dans la région, l’écart entre les femmes nées à l’étranger et celles nées en France est toutefois moins marqué qu’au niveau national. Ce surcroît de décès des personnes nées au Maghreb s’observe également chez les hommes. Il peut s’expliquer en partie par une surreprésentation dans les métiers les plus exposés au risque de contamination, par un recours accru aux transports en commun pour aller travailler ou encore par des logements plus exigus compliquant la distanciation.
Si l’effet de la crise sanitaire sur la mortalité semble moins important pour les femmes que pour les hommes, dans la région comme en France, les femmes ont en revanche davantage subi ses conséquences sur les parcours de soin (encadré 1).
Au-delà de ses conséquences sanitaires, la crise a également perturbé de nombreuses activités économiques et affecté tous les pans de la vie quotidienne. L’exposition à la crise diffère entre femmes et hommes pour des raisons liées aux emplois exercés ou aux conditions de vie.
Les femmes très présentes parmi les métiers « de première ligne »
Au printemps 2020, lors du premier confinement de la population lié à l’épidémie de Covid-19, six emplois sur dix dans les métiers « de première ligne » étaient occupés par des femmes en Provence-Alpes-Côte d’Azur, comme au niveau national. Elles ont continué d’exercer leur profession sur leur lieu de travail habituel, pour fournir des biens et des services de première nécessité à la population, notamment pour se nourrir ou se soigner. Parmi ces professions très exposées, les métiers de l’aide à domicile, du soin et de la vente dans les commerces « essentiels » sont très féminisés : au moins deux tiers des postes sont occupés par des femmes.
Les femmes qui exercent un métier de première ligne sont plus souvent à temps partiel que les hommes (33 % contre 10 %). C’est le cas par exemple des femmes aides à domicile : 80 % sont à temps partiel contre la moitié des hommes de cette profession. Parmi les personnels de caisse ou de la vente dans les commerces « essentiels », 44 % des femmes travaillent à temps partiel, contre 22 % des hommes. En raison de ce temps de travail plus faible, mais également d’un salaire horaire moindre, le salaire net médian des femmes est inférieur de 15 % à celui des hommes (figure 2). Cet écart en défaveur des femmes s’observe à tous les niveaux de l’échelle des salaires. Il est particulièrement marqué pour les 10 % les moins bien rémunérés : dans la région, le premier décile des femmes salariées de première ligne est inférieur de 29 % à celui des hommes.
tableauFigure 2 – Nombre et part de femmes, salaire médian et écart de salaire entre les femmes et les hommes dans les métiers de « première ligne » en Provence-Alpes-Côte d’Azur en 2018, par métier
| Métier | Nombre de femmes (salariées et non salariées) | Part de femmes (en %) | Salaire mensuel net médian des femmes salariées (en euros) | Écart de salaire médian entre les femmes et les hommes (en %) |
|---|---|---|---|---|
| Ensemble des métiers de « première ligne » | 234 670 | 59 | 1 570 | -15 |
| Dont Aide à domicile | 39 360 | 95 | 1 000 | -17 |
| Caissier, vendeur de commerces « essentiels » | 33 570 | 66 | 1 350 | -7 |
| Infirmier hospitalier | 30 620 | 85 | 2 150 | -4 |
| Aide-soignant | 28 390 | 90 | 1 700 | -5 |
| Agent hospitalier | 19 490 | 78 | 1 440 | -2 |
| Agent d’entretien | 12 850 | 65 | 1 030 | -24 |
- Note : pour le calcul des salaires mensuels nets médians, les non-salariés sont exclus du champ. Seule la rémunération correspondant à l’emploi principalement exercé au cours de l’année est retenu. Les salaires sont considérés temps pleins et partiels confondus.
- Lecture : en Provence-Alpes-Côte d’Azur, 39 360 femmes sont aides à domicile. Les femmes représentent 95 % des personnes exerçant ce métier. Quand elles sont salariées, la moitié des femmes aides à domicile perçoivent moins de 1 000 euros par mois. Ce salaire médian est intérieur de 17 % à celui des hommes exerçant le même métier.
- Sources : Insee, recensement de la population 2018 ; DADS-DSN 2018.
Les femmes à la tête de famille monoparentale vivent plus souvent dans des logements trop petits
Durant les confinements, les familles ont dû passer davantage de temps ensemble dans leur logement et y ont exercé les activités qu’elles effectuent habituellement à l’extérieur : travail, scolarité ou loisirs. En particulier, les inégalités se sont creusées en ce qui concerne le partage des tâches domestiques entre les femmes et les hommes (encadré 2).
Les difficultés de conditions de vie ont ainsi pu être amplifiées par le fait de vivre dans un logement trop petit au regard de la taille du ménage. Or, Provence-Alpes-Côte d’Azur est la région de province la plus touchée par la suroccupation (7,2 % des logements) en raison de la concentration de la population dans les communes denses et d’un parc de logements constitué majoritairement d’appartements.
Les conditions de logement diffèrent fortement selon le type de ménage (figure 3). Les familles monoparentales où les enfants vivent avec leurs mères, surreprésentées dans la région, sont celles qui souffrent le plus de suroccupation : 30 % vivent dans un logement trop petit, contre 25 % quand les enfants vivent avec leur père. Les difficultés de mode de garde accrues pour les familles monoparentales s’ajoutent à celles de l’exiguïté des logements lors des fermetures d’école.
Parmi les mères de familles monoparentales exerçant un métier de première ligne, 26 % vivent dans un logement suroccupé, dix points de plus qu’au niveau national. C’est le cas de 16 % des pères à la tête d’une famille monoparentale dans la région.
tableauFigure 3 – Part des logements suroccupés en Provence-Alpes-Côte d’Azur, par type de ménage
| Type de ménages | Nombre de logements | Part des logements suroccupés (en %) | Part des logements non suroccupés (en %) |
|---|---|---|---|
| Familles monoparentales femmes | 163 130 | 29,6 | 70,4 |
| Familles monoparentales hommes | 27 450 | 24,9 | 24,9 |
| Couples avec enfant(s) | 309 810 | 15,0 | 15,0 |
| Couples sans enfants | 28 900 | 2,4 | 2,4 |
| Autres | 163 310 | 16,8 | 16,8 |
- Note : l’épaisseur des barres est proportionnelle au nombre de logements de chaque catégorie.
- Lecture : 30 % des familles monoparentales ayant une femme à leur tête vivent dans un logement suroccupé.
- Champ : ménages de 2 personnes ou plus.
- Source : Insee, recensement de la population 2018, exploitation complémentaire.
graphiqueFigure 3 – Part des logements suroccupés en Provence-Alpes-Côte d’Azur, par type de ménage
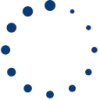
- Note : l’épaisseur des barres est proportionnelle au nombre de logements de chaque catégorie.
- Lecture : 30 % des familles monoparentales ayant une femme à leur tête vivent dans un logement suroccupé.
- Champ : ménages de 2 personnes ou plus.
- Source : Insee, recensement de la population 2018, exploitation complémentaire.
Des violences intrafamiliales en hausse
Au niveau national, 85 % des victimes de coups et blessures volontaires dans le cadre intrafamilial sont des femmes : dans neuf cas sur dix il s’agit alors de violences conjugales. En 2020, en Provence-Alpes-Côte d’Azur, 2,4 faits constatés de violences intrafamiliales envers des femmes ont été enregistrés pour 1 000 habitants, un taux supérieur à la moyenne de France métropolitaine (2,0 pour 1 000 habitants). Leur nombre a nettement progressé en 2020 dans la région comme en France métropolitaine (respectivement + 8 % entre 2019 et 2020 et + 9 %).
Encadré 1 – Un renoncement aux soins plus fréquent
Au niveau national, les femmes sont davantage concernées par le renoncement aux soins hors pandémie. Selon une étude de l'Odenore, cette différence s'est accentuée pendant le premier confinement : 64 % des femmes déclarent avoir renoncé à un acte médical dont elles avaient besoin, contre 53 % des hommes [Revil et al., 2020]. De plus, l’augmentation du syndrome dépressif lors du premier confinement a été plus marquée chez les femmes (+ 3,3 points contre + 1,8 point pour les hommes) [Drees, 2021].
Encadré 2 – Une répartition des tâches plus inégalitaire pendant le premier confinement
Au sein des couples, quelle que soit leur situation d’emploi, les femmes ont assumé une plus grande part de tâches domestiques que leur conjoint lors du premier confinement [Pailhé et al., 2020]. En France, la moitié des femmes et un peu plus d’un quart des hommes ont consacré au moins deux heures par jour en moyenne aux tâches domestiques courantes (cuisine, courses, ménage, linge). Les femmes ont également passé davantage de temps à s’occuper des enfants.
Encadré 3 – Partenariat
Cette étude est issue d’un partenariat avec la Direction régionale aux droits des femmes et à l’égalité de Provence-Alpes-Côte d’Azur.
Définitions
Pour fournir des biens et des services de première nécessité à la population, les travailleurs de « première ligne » ont continué d’exercer leur métier en se rendant quotidiennement sur leur lieu de travail au printemps 2020, au cours du premier confinement lié à l’épidémie de Covid-19. La liste de 35 métiers de première ligne utilisée dans cette étude a été définie par l’Observatoire régional de santé (ORS) Île-de-France en combinant la liste réglementaire établie par le ministère de la Santé sur les activités autorisées (arrêté ministériel du 15 mars 2020) et d’autres listes pragmatiques (guides de bonnes pratiques par métier, conseil de l’Institut national de recherche et de sécurité) éditées au mois de mars 2020. Un métier correspond ici à un croisement entre la nomenclature des professions et catégories socioprofessionnelles (PCS) et la nomenclature d’activités française (NAF). Cette liste de 35 métiers revêt inévitablement une part d’arbitraire comme toute classification, mais elle permet notamment de repérer les travailleurs qui ont été les plus concernés par ces activités lors du premier confinement.
Les commerces « essentiels » comprennent ici les supérettes, les supermarchés, les hypermarchés, les commerces de détail alimentaires, les commerces de détail de tabac, les commerces de détail de carburants et les commerces de détail de produits pharmaceutiques.
Le salaire net médian est celui en dessous duquel se situent les 50 % les moins rémunérés.
Le premier décile est le salaire en dessous duquel se situent les 10 % les moins rémunérés.
La suroccupation est mesurée en rapportant la composition du ménage au nombre de pièces du logement, les studios occupés par une personne étant exclus du champ. Un logement est suroccupé quand il lui manque au moins une pièce par rapport à la situation d’occupation « normale » définie ainsi : une pièce de séjour pour le ménage, une pièce pour chaque personne de référence d’une famille ou un couple, une pièce pour les personnes hors famille non célibataires ou les célibataires de 19 ans ou plus. Pour les célibataires de moins de 19 ans, on compte une pièce pour deux enfants s’ils sont de même sexe ou ont moins de 7 ans, sinon, une pièce par enfant.
Pour en savoir plus
Belle R., Meyer V., Sanzeri O., Zampini C., « Premier confinement : 392 000 travailleurs de « première ligne », en majorité des femmes », Insee Analyses Provence-Alpes-Côte d'Azur n° 97, décembre 2021.
Domens J., Mêlé J., « D’octobre 2020 à mai 2021, une nouvelle période de forte mortalité », Insee Flash Provence-Alpes-Côte d'Azur n° 74, novembre 2021.
Zampini C., « Surpeuplement, isolement, pauvreté : des ménages inégalement dotés face au confinement », Insee Flash Provence-Alpes-Côte d'Azur n° 62, mai 2020.
Joseph D., Trostiansky O., « Ouvrir dans un nouvel ongletCrise sanitaire et inégalités de genre », Les Avis du Cese, mars 2021.
Barbara M.-A., « Ouvrir dans un nouvel ongletInégalités de conditions de vie face au confinement », Trésor-Éco n° 264, août 2020.
Service statistique ministériel de la sécurité intérieure, « Ouvrir dans un nouvel ongletInsécurité et délinquance en 2020 : bilan statistique », avril 2021.
Papon S., Robert-Bobée I., « Une hausse des décès deux fois plus forte pour les personnes nées à l’étranger que pour celles nées en France en mars-avril 2020 », Insee Focus n° 198, juillet 2020.
Drees, « Ouvrir dans un nouvel ongletConfinement du printemps 2020 : une hausse des syndromes dépressifs,surtout chez les 15-24 ans », Études et résultats n° 1185, mars 2021.
Revil H., Blanchoz J-M., Bailly S., Olm C., « Ouvrir dans un nouvel ongletRenoncer à se soigner pendant le confinement. Premiers résultats d’enquête », Odenore/Assurance maladie en collaboration avec HP2 et VizGet, décembre 2020.
Pailhé A., Raynaud E., Solaz A., « Même quand elles travaillaient à l’extérieur, les femmes ont consacré plus de temps que les hommes aux tâches domestiques et à s’occuper des enfants », in France, portrait social, coll. « Insee références », décembre 2020.