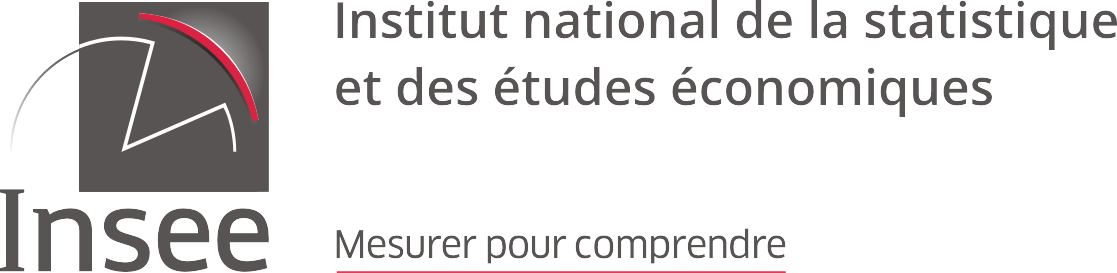Sécurité et société Édition 2021
L’Insee et le Service statistique ministériel de la sécurité intérieure (SSMSI) du ministère de l’Intérieur, en collaboration avec le Service statistique ministériel de la Justice (SDSE), présentent dans cette édition inédite de la collection « Insee Références » intitulée Sécurité et société un panorama synthétique des connaissances sur les phénomènes de délinquance et leur traitement par la justice.
Recours aux associations d’aide aux victimes
Insee Références
Paru le :09/12/2021
En 2019, près de 300 000 personnes ont fait appel à une association d’aide aux victimes (AAV) après avoir subi une atteinte. Le recours à une association est peu répandu au regard des 2 millions de victimes personnes physiques dont l’affaire est passée devant la justice en 2019, mais surtout au regard des plus de 7 millions de personnes de 14 ans ou plus déclarant avoir subi au cours de l’année 2018 au moins un vol avec violence (166 000), des violences physiques (710 000), un vol sans violence (970 000), ou bien encore des menaces (1,8 million) ou injures (4,9 millions), qu’elles aient ou non déposé plainte.
Parmi les victimes qui ont eu recours à l’aide d’une association, 46 % l’ont connue par les services de police ou de gendarmerie, 21 % sur les conseils de leur entourage et 19 % sur ceux du personnel d’un tribunal (figure 1). Seules 1 % des victimes ont eu connaissance de l’AAV par le 116 006, numéro dédié aux victimes d’infractions. Ce service téléphonique est d’ailleurs assez peu connu des victimes accompagnées par les AAV (11 % le connaissent). Par ailleurs, 14 % des victimes ont été directement contactées par l’association.
tableauFigure 1 – Mode de connaissance de l’existence d’associations d’aide aux victimes, en 2019
| Par les services de police ou de gendarmerie | 46 |
|---|---|
| Par des relations | 21 |
| Par le personnel du tribunal | 19 |
| Victimes contactées directement par l'association | 14 |
| Par une maison de justice et du droit ou un point d'accès au droit | 14 |
| Par des plaquettes, des affiches | 13 |
| Par l'hôpital | 11 |
| Par une assistante sociale | 11 |
| Par internet | 10 |
- Note : les victimes peuvent avoir connu l’association de plusieurs façons, le total est donc supérieur à 100 %.
- Lecture : en 2019, 46 % des victimes ont connu l’association par les services de police ou de gendarmerie.
- Champ : victimes personnes physiques ayant eu recours à une association d’aide aux victimes (AAV).
- Source : ministère de la Justice, SDSE, enquête de satisfaction 2019 auprès des usagers des AAV.
graphiqueFigure 1 – Mode de connaissance de l’existence d’associations d’aide aux victimes, en 2019

- Note : les victimes peuvent avoir connu l’association de plusieurs façons, le total est donc supérieur à 100 %.
- Lecture : en 2019, 46 % des victimes ont connu l’association par les services de police ou de gendarmerie.
- Champ : victimes personnes physiques ayant eu recours à une association d’aide aux victimes (AAV).
- Source : ministère de la Justice, SDSE, enquête de satisfaction 2019 auprès des usagers des AAV.
Les victimes ayant sollicité l’appui d’une association sont majoritairement des femmes (71 %) alors qu’elles représentent 45 % des personnes victimes recensées dans les affaires traitées par les parquets. Les trois quarts des victimes ayant sollicité une association déclarent avoir subi principalement une atteinte à la personne (figure 2). Il s’agit alors plus souvent d’un préjudice physique ou moral (77 %) que d’un harcèlement (34 %) ou d’une agression sexuelle (18 %). Le quart restant déclare avoir subi principalement une atteinte aux biens ; il s’agit alors une fois sur deux d’un vol. Les hommes comme les femmes déclarent majoritairement avoir subi une atteinte à la personne (respectivement 66 % et 82 %). Cependant, les femmes sont proportionnellement plus nombreuses à déclarer une agression à caractère sexuel (22 % contre 6 % pour les hommes) ou un harcèlement (41 % contre 15 %), tandis que les hommes se disent davantage victimes d’accident de la route (17 % contre 10 % pour les femmes).
tableauFigure 2 – Infractions subies par les victimes ayant eu recours à une association d'aide aux victimes, en 2019
| L'usager de l'association a déclaré avoir été victime |
Femmes | Hommes | Ensemble |
|---|---|---|---|
| principalement d'une atteinte aux biens, dont... | 18 | 34 | 23 |
| vol | 51 | 46 | 49 |
| extorsion, escroquerie, abus de confiance | 38 | 38 | 38 |
| destruction, dégradation | 35 | 40 | 38 |
| cybercriminalité | 3 | 4 | 3 |
| principalement d'une atteinte à la personne, dont... | 82 | 66 | 77 |
| atteinte à l'intégrité physique ou morale (y c. coups et blessures) | 77 | 77 | 77 |
| harcèlement | 41 | 15 | 34 |
| agression sexuelle (y c. viol) | 22 | 6 | 18 |
| accident de la route | 10 | 17 | 12 |
| discrimination, racisme, antisémitisme, homophobie, LGBTI-phobies , sexisme | 9 | 10 | 9 |
| acte terroriste, accident collectif | 1 | 3 | 2 |
- LGBTI : lesbiennes, gays, bisexuels, transgenres et intersexes.
- Note : les victimes interrogées déclarent si l’infraction subie la plus grave était une atteinte aux biens ou à la personne, puis indiquent les infractions subies relevant de ce type.
- Lecture : en 2019, 23 % des victimes ayant eu recours à une AAV ont principalement subi une atteinte aux biens ; parmi elles, 49 % ont été victimes d’un vol.
- Champ : victimes personnes physiques ayant eu recours à une association d’aide aux victimes (AAV).
- Source : ministère de la Justice, SDSE, enquête de satisfaction 2019 auprès des usagers des AAV.
L’aide apportée par les associations est diverse : 49 % des victimes ont bénéficié d’un appui juridique (démarches pour se constituer partie civile, pour déposer plainte, pour demander des dommages et intérêts), 45 % d’un accompagnement psychologique et 25 % d’un soutien administratif ou social, tel qu’une orientation vers une structure d’hébergement (figure 3). Toutefois, 17 % des victimes considèrent n’avoir reçu aucune aide.
tableauFigure 3 – Accompagnement apporté aux victimes par les associations d’aide aux victimes, en 2019
| Aide juridique seule | 24 |
|---|---|
| Aide psychologique seule | 20 |
| Aucune aide | 17 |
| Aides juridique et psychologique | 13 |
| Aide administrative ou sociale seule | 7 |
| Aides juridique et administrative ou sociale | 6 |
| Aides psychologique et administrative ou sociale | 6 |
| Aides juridique, psychologique et administrative ou sociale | 6 |
| Ne sait pas | 1 |
| Ensemble | 100 |
- Lecture : en 2019, 13 % des victimes ayant eu recours à une AAV ont bénéficié à la fois d’un accompagnement juridique et d’un accompagnement psychologique.
- Champ : victimes personnes physiques ayant eu recours à une association d’aide aux victimes (AAV).
- Source : ministère de la Justice, SDSE, enquête de satisfaction 2019 auprès des usagers des AAV.
De manière générale, les bénéficiaires estiment que l’aide qui leur a été la plus utile est le soutien juridique (39 %), suivi de l’accompagnement psychologique (35 %) et administratif ou social (16 %) (figure 4). Cette hiérarchie varie selon l’atteinte subie : pour les victimes d’atteinte aux biens, l’aide considérée la plus utile est l’accompagnement juridique (54 %), tandis que les victimes d’atteinte à la personne mettent en avant l’accompagnement psychologique (42 %).
tableauFigure 4 – Accompagnement jugé le plus utile par les victimes selon l’atteinte subie, en 2019
| Atteinte aux biens |
Atteinte à la personne |
Ensemble des victimes |
|
|---|---|---|---|
| Accompagnement juridique | 54 | 35 | 39 |
| Accompagnement psychologique | 12 | 42 | 35 |
| Accompagnement administratif ou social | 24 | 13 | 16 |
| Aucun | 8 | 8 | 8 |
| Ne sait pas | 2 | 2 | 2 |
| Ensemble | 100 | 100 | 100 |
- Lecture : en 2019, 54 % des victimes d'atteinte aux biens ont jugé que l’accompagnement juridique était le plus utile.
- Champ : victimes personnes physiques ayant eu recours à une association d’aide aux victimes (AAV).
- Source : ministère de la Justice, SDSE, enquête de satisfaction 2019 auprès des usagers des AAV.
graphiqueFigure 4 – Accompagnement jugé le plus utile par les victimes selon l’atteinte subie, en 2019

- Lecture : en 2019, 54 % des victimes d'atteinte aux biens ont jugé que l’accompagnement juridique était le plus utile.
- Champ : victimes personnes physiques ayant eu recours à une association d’aide aux victimes (AAV).
- Source : ministère de la Justice, SDSE, enquête de satisfaction 2019 auprès des usagers des AAV.
Si les hommes considèrent l’aide juridique comme l’apport qui leur a été le plus utile (45 %), les femmes sont plus sensibles à l’accompagnement psychologique (40 %), en lien notamment avec la nature des atteintes qu’ils ou elles ont subies.
Définitions
Les associations d’aide aux victimes, conventionnées et subventionnées par le ministère de la Justice, accueillent les victimes d’infractions pénales, les informent sur leurs droits, leur proposent une aide psychologique, les accompagnent et les assistent tout au long de la procédure judiciaire et les orientent si nécessaire vers des services spécialisés.
Pour en savoir plus
« Ouvrir dans un nouvel ongletLes victimes d’infractions pénales - usagères des associations d’aide aux victimes en 2019 », Infostat Justice n° 177, ministère de la Justice, août 2020.