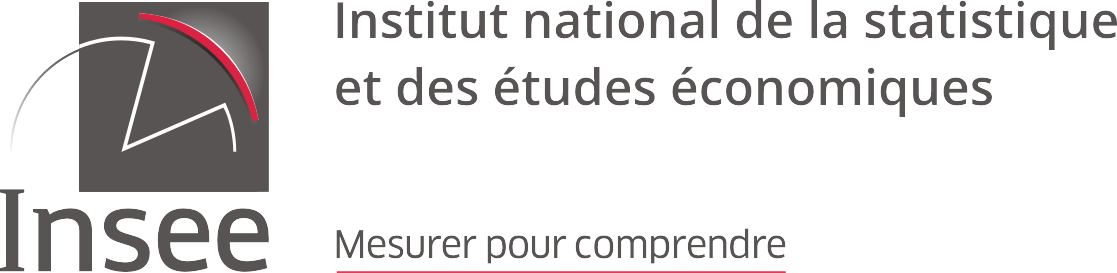Insee Flash Réunion ·
Septembre 2023 · n° 259
Insee Flash Réunion ·
Septembre 2023 · n° 259 Un quart des personnes originaires de La Réunion vivant dans l’Hexagone se déclarent
victimes de discriminations ou de traitements inégalitaires
Un quart des personnes originaires de La Réunion vivant dans l’Hexagone se déclarent
victimes de discriminations ou de traitements inégalitaires
Parmi les natifs et descendants de natifs de La Réunion vivant en France métropolitaine, 25 % déclarent avoir subi des traitements inégalitaires ou des discriminations, contre 14 % des natifs de l’Hexagone dont les parents y sont aussi nés. C’est toutefois moins que parmi les personnes originaires des autres Outre-mer. La principale source de discrimination déclarée est la couleur de peau et l’origine, suivie par le sexe. C’est sur le lieu de travail que la majorité des discriminations déclarées sont vécues. Lorsqu’elles s’estiment discriminées, la principale réaction des personnes originaires de La Réunion est la résignation.
- Les natifs et descendants de natifs de La Réunion moins souvent confrontés à la discrimination que les personnes originaires des autres Outre-mer
- Les principaux motifs de discriminations pour les personnes originaires de La Réunion sont la couleur de peau et l’origine
- Le sexisme est le deuxième motif de discrimination déclaré par les personnes originaires de La Réunion
- La majorité des discriminations déclarées ont lieu sur le lieu de travail
- La résignation est la principale réaction pour les personnes originaires de La Réunion
Les natifs et descendants de natifs de La Réunion moins souvent confrontés à la discrimination que les personnes originaires des autres Outre-mer
Les discriminations sont au cœur du débat public depuis plusieurs décennies. Dans ce contexte, l’enquête Trajectoires et Origines de l’Insee et l’Ined vise à mesurer l’expérience déclarée des discriminations vécues par les personnes vivant dans l’Hexagone.
Au cours des cinq dernières années, 25 % des natifs et descendants de natifs de La Réunion vivant dans l’Hexagone déclarent avoir été victimes de discriminations ou de traitements inégalitaires : 26 % parmi les natifs et 23 % parmi les descendants de natifs. Cette part est bien plus élevée que parmi les personnes nées dans l’Hexagone dont les deux parents y sont aussi nés (14 %), appelées par la suite « population issue de l’Hexagone ». Les discriminations déclarées par les originaires de La Réunion sont moindres que pour les personnes originaires des autres Outre-mer (34 %), en particulier pour les originaires de la Martinique (37 %) et de la Guadeloupe (36 %).
Les principaux motifs de discriminations pour les personnes originaires de La Réunion sont la couleur de peau et l’origine
Parmi les personnes originaires de La Réunion déclarant avoir été discriminées, 72 % estiment l’avoir été à cause de leur couleur de peau ou de leur origine. Ainsi, 18 % des personnes originaires de La Réunion vivant dans l’Hexagone ont ressenti ce type de discrimination (figure 1). Cette part est bien plus élevée parmi les originaires de la Martinique (31 %) et de la Guadeloupe (32 %). En revanche, seuls 2 % des natifs de l’Hexagone dont les parents y sont aussi nés déclarent avoir subi des discriminations liées à leur couleur de peau ou à leur origine.
tableauFigure 1 – Déclarations de discriminations ou de traitements inégalitaires subis en raison de la couleur de peau ou de l’origine
| Origine | A déclaré avoir subi des discriminations ou des traitements inégalitaires à cause de sa couleur de peau ou son origine |
|---|---|
| Originaires¹ de La Réunion | 18 |
| Originaires¹ de la Guadeloupe | 32 |
| Originaires¹ de la Martinique | 31 |
| Population issue de l’Hexagone² | 2 |
- 1. Originaires : personnes nées à La Réunion, en Guadeloupe ou en Martinique ou dont au moins l’un des parents y est né.
- 2. Population issue de l’Hexagone : personnes nées dans l’Hexagone dont les deux parents y sont nés.
- Note : dans cette figure, il n’est pas fait mention des autres départements et territoires d’Outre-mer, car le nombre de personnes concernées dans l’enquête n’est pas suffisant (Pour comprendre).
- Lecture : 18 % des personnes originaires de La Réunion déclarent avoir subi des traitements inégalitaires ou des discriminations au cours des cinq dernières années à cause de leur couleur de peau ou de leur origine.
- Champ : France métropolitaine, personnes de 18 à 59 ans vivant en logement ordinaire.
- Sources : Ined-Insee, enquête Trajectoires et Origines 2 (2019-2020).
graphiqueFigure 1 – Déclarations de discriminations ou de traitements inégalitaires subis en raison de la couleur de peau ou de l’origine

- 1. Originaires : personnes nées à La Réunion, en Guadeloupe ou en Martinique ou dont au moins l’un des parents y est né.
- 2. Population issue de l’Hexagone : personnes nées dans l’Hexagone dont les deux parents y sont nés.
- Note : dans cette figure, il n’est pas fait mention des autres départements et territoires d’Outre-mer, car le nombre de personnes concernées dans l’enquête n’est pas suffisant (Pour comprendre).
- Lecture : 18 % des personnes originaires de La Réunion déclarent avoir subi des traitements inégalitaires ou des discriminations au cours des cinq dernières années à cause de leur couleur de peau ou de leur origine.
- Champ : France métropolitaine, personnes de 18 à 59 ans vivant en logement ordinaire.
- Sources : Ined-Insee, enquête Trajectoires et Origines 2 (2019-2020).
Les personnes dont les deux parents sont natifs de La Réunion ainsi que les natifs eux-mêmes déclarent plus fréquemment que les autres originaires de l’île une expérience de discrimination liée à la couleur de peau ou à l’origine et les 41-59 ans moins fréquemment, toutes choses égales par ailleurs (figure 2 et Pour comprendre). Ainsi, 26 % des personnes ayant deux parents natifs de La Réunion et 21 % des natifs déclarent avoir subi ce type de discrimination, contre 11 % des personnes dont un seul des deux parents est natif de l’île. Inversement, 8 % des 41-59 ans originaires de La Réunion déclarent une discrimination liée à la couleur de peau ou à l’origine, soit bien moins que parmi les 18-30 ans (23 %) et les 31-40 ans (21 %). Ces constats sont également observés parmi les personnes originaires des autres Outre-mer.
En revanche, déclarer une discrimination liée à la couleur de peau ou l’origine ne dépend pas du sexe, du type de quartier de résidence, de la situation familiale, du niveau de diplôme ou de la catégorie socio-professionnelle.
tableauFigure 2 – Facteurs influençant le risque de déclarer avoir subi des traitements inégalitaires ou des discriminations liés à l’origine ou à la couleur de peau parmi les personnes originaires de La Réunion
| Facteurs | Effet toutes choses égales par ailleurs1 | Part de personnes ayant déclaré avoir subi des traitements inégalitaires ou des discriminations liées à la couleur de peau ou à l’origine (en %) |
|---|---|---|
| Âge | ||
| 18-30 ans | n.s | 23 |
| 31-40 ans | Réf. | 21 |
| 41-59 ans | - - - | 8 |
| Type d’ascendance | ||
| Natif de La Réunion | + + | 21 |
| Descendant de deux parents natifs de La Réunion | + + + | 26 |
| Descendant d’un seul parent natif de La Réunion | Réf. | 11 |
- 1. Cette colonne présente les résultats d’un modèle statistique, dit « logit », qui évalue le risque pour les personnes originaires de La Réunion et vivant en France métropolitaine de déclarer avoir subi des traitements inégalitaires ou des discriminations liées à la couleur de la peau ou à l’origine, toutes choses égales par ailleurs (Pour comprendre). D’autres variables que celles présentées dans cette figure ont été incluses dans le modèle mais leur effet est peu ou pas statistiquement significatif : le sexe, le diplôme, la catégorie socioprofessionnelle, le lieu de résidence, l’état de santé et la situation familiale ; elles n’apparaissent donc pas dans cette figure.
- Lecture : par rapport aux 31-40 ans originaires de La Réunion et vivant en France métropolitaine (catégorie prise comme modalité de référence dans le modèle statistique pour l’âge : Réf.), les 41-59 ans ont un risque largement inférieur (symbolisé dans la figure par - - - ) de déclarer des discriminations liées à leur origine ou leur couleur de peau. Parmi ces personnes de 41-59 ans, 8 % déclarent une discrimination de ce type contre 21 % des 31-40 ans.
- Champ : France métropolitaine, personnes de 18 à 59 ans originaires de La Réunion vivant en logement ordinaire.
- Sources : Ined-Insee, enquête Trajectoires et Origines 2 (2019-2020).
Le sexisme est le deuxième motif de discrimination déclaré par les personnes originaires de La Réunion
Après la couleur de peau et l’origine, le motif sexiste est celui qui est le plus mis en avant. Parmi les personnes originaires de La Réunion, 5 % déclarent avoir subi des discriminations à cause de leur sexe. Cette part atteint 10 % parmi les femmes originaires de l’île, soit autant que parmi les femmes nées dans l’Hexagone dont les deux parents y sont nés. Pour les femmes originaires de la Guadeloupe et de la Martinique, cette part est plus élevée (14 %). Au total, 36 % des femmes originaires de La Réunion qui déclarent avoir été discriminées disent l’avoir été à cause de leur sexe. À caractéristiques égales, les femmes cadres originaires de La Réunion ressentent plus fréquemment que celles qui ne sont pas cadres des discriminations liées au sexe, tout comme les femmes de la population issue de l’Hexagone.
Par ailleurs, les femmes originaires de La Réunion déclarant des discriminations liées à leur couleur de peau ou leur origine sont également plus enclines à déclarer des discriminations liées à leur sexe. 16 % des femmes originaires de La Réunion déclarant avoir été discriminées à cause de leur origine ou leur couleur de peau ont également déclaré des discriminations sexistes, contre 7 % de celles qui n’en ont pas déclaré. Cela est également vrai pour l’ensemble des femmes originaires de la Guadeloupe et de la Martinique.
Le poids est également un motif de discrimination ou de traitement inégalitaire souvent déclaré, notamment par les jeunes originaires de La Réunion. Bien qu’ils ne soient pas davantage en surpoids que les plus âgés, 7 % des 17-30 ans déclarent avoir subi des discriminations liées à leur poids, contre 1 % des personnes âgées de 31 à 59 ans. Ainsi, ce motif est cité par 12 % des personnes déclarant avoir été discriminées, en particulier parmi les 17-30 ans (25 %). D’autres motifs de discriminations sont déclarés, mais moins souvent, comme l’âge, la religion, l’orientation sexuelle ou le quartier d’habitation. Certains motifs, comme celui de l’âge, sont moins souvent déclarés par les personnes originaires de La Réunion : cela concerne 1 % d’entre elles contre 3 % de la population issue de l’Hexagone.
La majorité des discriminations déclarées ont lieu sur le lieu de travail
Pour les personnes originaires de La Réunion, tout comme pour la population issue de l’Hexagone, le lieu de travail est la principale localisation déclarée de discrimination. Ainsi, 13 % des originaires de l’île déclarent y avoir subi des discriminations, soit 5 points de plus que pour la population issue de l’Hexagone. Ce sont 51 % des personnes ayant déclaré avoir été discriminées qui citent ce lieu. En particulier, 21 % des natifs et descendants de natifs de La Réunion ont déclaré s’être fait injustement licencier, refuser un emploi ou une promotion, contre 15 % des personnes de la population issue de l’Hexagone.
Parmi ceux qui ont recherché un logement, 12 % déclarent s’en être injustement fait refuser un, contre 8 % de la population issue de l’Hexagone.
Les personnes originaires de La Réunion déclarent par ailleurs plus souvent des discriminations lors de contrôles de police (3 % contre 0,5 % de la population issue de l’Hexagone). Parmi l’ensemble des originaires de l’île ayant déclaré une discrimination, cette part s’élève à 12 %. De plus, les personnes originaires de La Réunion déclarent également davantage avoir été discriminées à l’école, dans les transports, dans le voisinage et sur les lieux de leurs loisirs que la population issue de l’Hexagone.
La résignation est la principale réaction pour les personnes originaires de La Réunion
Suite à une expérience discriminatoire, les personnes originaires de La Réunion font principalement preuve de résignation. En effet, 54 % d’entre elles n’ont rien fait en pensant que cela ne servirait à rien, contre 42 % des personnes de la population issue de l’Hexagone (figure 3). Ces dernières, dans la moitié des cas, en ont davantage parlé à leur famille, leurs amis ou leurs collègues ou ont contesté, se sont indignées (dans 43 % des cas). Seules 33 % des personnes originaires de l’île déclarent avoir contesté ou s’être indignées.
Cette résignation est d’autant plus forte quand l’un des motifs déclarés est la couleur de peau ou l’origine : dans ce cas, 66 % des personnes originaires de La Réunion déclarent n’avoir rien fait en pensant que cela ne servait à rien.
tableauFigure 3 – Principales réactions à la suite de discriminations
| Réactions déclarées | Originaires de La Réunion | Population issue de l’Hexagone |
|---|---|---|
| Je n’ai rien fait car je pensais que ça ne servirait à rien | 54 | 42 |
| J’en ai parlé à ma famille, mes amis ou mes collègues | 49 | 51 |
| J’ai contesté ou me suis indigné | 33 | 43 |
- Note : plusieurs réactions pouvant être déclarées, la somme peut dépasser 100 %.
- Lecture : 33 % des personnes originaires de La Réunion et vivant dans l’Hexagone ont déclaré avoir contesté ou s’être indignées suite à une expérience discriminatoire.
- Champ : France métropolitaine, personnes de 18 à 59 ans vivant en logement ordinaire.
- Sources : Ined-Insee, enquête Trajectoires et Origines 2 (2019-2020).
graphiqueFigure 3 – Principales réactions à la suite de discriminations

- Note : plusieurs réactions pouvant être déclarées, la somme peut dépasser 100 %.
- Lecture : 33 % des personnes originaires de La Réunion et vivant dans l’Hexagone ont déclaré avoir contesté ou s’être indignées suite à une expérience discriminatoire.
- Champ : France métropolitaine, personnes de 18 à 59 ans vivant en logement ordinaire.
- Sources : Ined-Insee, enquête Trajectoires et Origines 2 (2019-2020).
Pour comprendre
Coproduite par l’Ined et l’Insee, l’enquête Trajectoires et Origines 2 (TeO2), collectée en 2019-2020, est une réédition de l’enquête TeO1 (2008-2009).
Le champ de TeO2 est celui des personnes de 18 à 59 ans vivant en logement ordinaire en France métropolitaine. L’enquête a été effectuée auprès d’environ 27 200 personnes, avec l’objectif de réaliser des analyses fines sur les principaux groupes de population qui ont une expérience directe ou indirecte de la migration vers la France métropolitaine. Ainsi, environ 800 natifs d’Outre-mer et 850 de leurs enfants nés dans l’Hexagone, surreprésentés dans cette enquête, ont été interrogés. Cela représente 1 650 personnes au total, dont environ 450 natifs ou descendants de natifs de La Réunion.
L’enquête TeO2 permet notamment de mesurer l’expérience auto-déclarée de discriminations. Elles sont susceptibles d’être causées par plusieurs motifs, parmi lesquels le sexe, l’âge, la couleur de peau, l’origine, la religion, l’orientation sexuelle, le poids, l’état de santé ou le handicap. Ainsi, parmi les personnes originaires de La Réunion, 63 % ont déclaré un seul motif, 28 % en ont déclaré deux, 9 % en ont déclaré trois ou plus. Le nombre moyen de motifs déclaré s’établit à 1,44.
Les résultats présentés dans la colonne « Effet toutes choses égales par ailleurs » de la figure 2 sont issus d’un modèle statistique, dit « logit ». Il évalue le risque pour les personnes originaires de La Réunion et vivant en France métropolitaine de déclarer avoir subi des traitements inégalitaires ou des discriminations liées à l’origine ou à la couleur de peau toutes choses égales par ailleurs, c’est-à-dire à âge, type d’ascendance, diplôme, lieu de résidence, état de santé, situation familiale donnés. Les variables peu ou pas statistiquement significatives sur le risque de déclarer ces types de traitements inégalitaires ou de discriminations n’ont pas été intégrées dans la figure 2. Les effets mentionnés des différentes modalités sont calculés à l’aide des rapports de risque (odds ratio) : pour chaque variable, les odds ratio permettent de comparer les différentes modalités avec la modalité de référence (Réf.).
La Réunion, la Martinique et la Guadeloupe sont les seuls départements d’Outre-mer dont les personnes originaires sont suffisamment bien représentées dans l’enquête pour permettre une exploitation statistique.
Définitions
Dans le cadre de cette étude, les personnes originaires d’un département d’Outre-mer sont définies comme les personnes qui y sont nées ou qui sont nées dans l’Hexagone en ayant au moins un de leurs parents qui y est né.
La population issue de l’Hexagone regroupe les personnes qui sont nées dans l’Hexagone et dont les deux parents y sont également nés.
Pour en savoir plus
Lê J., Rouhban O., Tanneau P., Beauchemin C., Ichou M., Simon P., « En dix ans, le sentiment de discrimination augmente, porté par les femmes et le motif sexiste », Insee Première no 1911, juillet 2022.
Beauchemin C., Ichou M., Simon P., « Ouvrir dans un nouvel ongletTrajectoires et Origines 2 : présentation d’une enquête sur la diversité des populations en France », Population, Ined, juillet 2023.
Thao Khamsing W., Guin O., Merly-Alpa T., Paliod N., « Enquête Trajectoires et Origines 2, de la conception à la réalisation », Documents de travail no 2022/02, Insee, juillet 2022.
Beauchemin C., Hamel C., Simon P., « Ouvrir dans un nouvel ongletTrajectoires et origines – Enquête sur la diversité des populations en France », Grandes Enquêtes, Ined, 2016.
Beauchemin C., Hamel C., Lesné M., Simon P., « Ouvrir dans un nouvel ongletLes discriminations : une question de minorités visibles », Population et Sociétés no 466, Ined, avril 2010.