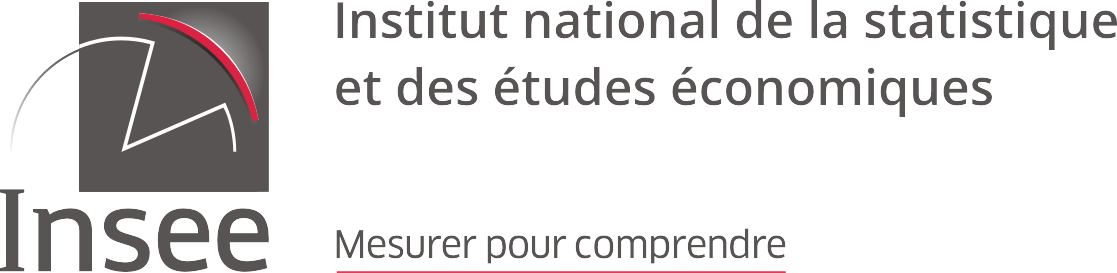Insee Analyses Nouvelle-Aquitaine ·
Juillet 2021 · n° 99
Insee Analyses Nouvelle-Aquitaine ·
Juillet 2021 · n° 99 8 100 emplois dans le complexe industrialo-portuaire de Bordeaux, équilibrés entre
activités maritimes et non maritimes
8 100 emplois dans le complexe industrialo-portuaire de Bordeaux, équilibrés entre
activités maritimes et non maritimes
Fin 2017, 8 100 salariés travaillent au sein du complexe industrialo-portuaire (CIP) de Bordeaux, dans une répartition plutôt équilibrée entre activités maritimes et non maritimes. Le CIP se positionne ainsi comme un complexe d’organisation des transports de marchandises et de transformation industrielle. Son activité se concentre sur trois communes : Bassens, Bordeaux et Bruges. Sa contribution à l’économie de l’ensemble du département est limitée alors que ses retombées économiques locales sont parfois importantes. Par rapport au reste de la Gironde, les emplois dépendent davantage de groupes à dimension internationale et sous contrôle français. Les hommes y sont majoritaires et les ouvriers largement surreprésentés. Par ailleurs, les rémunérations sont notablement plus élevées et les emplois plus stables.
- 8 100 salariés sur le complexe industrialo-portuaire de Bordeaux
- Des retombées économiques locales notables
- Une répartition assez équilibrée des activités maritimes et non maritimes
- Un tissu productif à dimension internationale et des centres de décision français
- Un milieu ouvrier, très masculin
- Des emplois plus stables et des rémunérations attractives
- Des trajets domicile-travail plus longs
- Encadré - Port de Bordeaux, acteur de la transition du territoire néo-aquitain
Port d’estuaire situé sur la façade Atlantique, le Grand Port Maritime de Bordeaux se compose de sept terminaux répartis le long de l’estuaire de la Gironde : Le Verdon-sur-Mer, Pauillac, Blaye, Ambès, Blanquefort-Parempuyre, Bassens et Bordeaux (figure 1).
tableauFigure 1 – Répartition des emplois du complexe industrialo-portuaire de Bordeaux dans les communes de Gironde
| Communes | Nombre d’emplois |
|---|---|
| Bassens | 3 195 |
| Bordeaux | 1 411 |
| Bruges | 1 096 |
| Tresses | 377 |
| Ambès | 293 |
| Blanquefort | 278 |
| Mérignac | 256 |
| Saint-Loubès | 227 |
| Lormont | 170 |
| Ambarès-et-Lagrave | 155 |
| Le Verdon-sur-Mer | 138 |
| Pauillac | 68 |
| Pessac | 55 |
| Canéjan | 60 |
| Bègles | 44 |
| Mios | 38 |
| Blaye | 16 |
| Landiras | 16 |
| La-Teste-de-Buche | 7 |
| Artigues-près-Bordeaux | 5 |
| Saint-André-de-Cubzac | 12 |
| Marcheprime | 8 |
| Saint-Vivien-de-Médoc | 8 |
| Castets et Castillon | 7 |
| Grayan-et-l'Hôpital | 9 |
| Eysines | 4 |
| Cestas | 2 |
| Le Bouscat | 0 |
| Bayon-sur-gironde | 1 |
| Saint-Genès-de-Blaye | 2 |
| Communes hors Gironde | 101 |
- Source : Insee, Flores 2017
graphiqueFigure 1 – Répartition des emplois du complexe industrialo-portuaire de Bordeaux dans les communes de Gironde

- Source : Insee, Flores 2017
Proposant des services portuaires polyvalents permettant l’acheminement et la transformation d’une grande diversité de marchandises et de matières premières, le port de Bordeaux constitue une interface logistique et une plateforme industrielle servant l’économie de la métropole de Bordeaux, de la Gironde et plus largement de la région Nouvelle-Aquitaine. Avec un trafic de 7,3 millions de tonnes de marchandises importées et exportées en 2017, le port de Bordeaux est avant tout un port de vrac où l’importation de produits pétroliers raffinés domine. Il possède également un positionnement stratégique sur les importations de conteneurs et de matières premières destinées aux industries locales. En matière d’exportation, son activité reste très diversifiée : si les céréales constituent un produit phare, le trafic est complété par l’exportation d’engrais, de tourteaux et d’huiles ainsi que, fait remarquable, de pétrole brut extrait en Aquitaine. Le port de Bordeaux anime un complexe industrialo-portuaire (CIP) majeur qui apporte une contribution significative à l’emploi et à la valeur ajoutée de nombreuses filières économiques du territoire. Il abrite également un écosystème dynamique qui englobe la fabrication de bateaux de plaisance, les opérations de maintenance, de réparation, de conversion ou encore de déconstruction de navires.
Le CIP se concentre principalement à proximité des zones bord à quai, également appelées zones industrialo-portuaires. Ces dernières abritent près de 70 % des établissements composant le CIP du port de Bordeaux. Au-delà de ces zones, le CIP s’étend également sur 20 communes du territoire girondin.
8 100 salariés sur le complexe industrialo-portuaire de Bordeaux
Fin 2017, le port de Bordeaux génère directement ou indirectement 8 100 emplois répartis dans 274 établissements (figure 2), formant ainsi le complexe industrialo-portuaire de Bordeaux (méthodologie). Comparé à d’autres ports de France métropolitaine, l’impact économique du CIP dans le département est faible, tant en emplois qu’en richesse produite.
tableauFigure 2 – Répartition des établissements et des emplois du CIP de Bordeaux par activités
| Famille | Sous-famille | Établissements | Emplois |
|---|---|---|---|
| Gestion du port | 15 | 601 | |
| Douanes, affaires maritimes, autorité portuaire | 4 | 68 | |
| Autres services liés au port | 11 | 533 | |
| Organisation des transports | 68 | 2 084 | |
| Affrètement et organisation des transports | 55 | 1 526 | |
| Messagerie, fret express | 5 | 369 | |
| Manutention portuaire | 8 | 189 | |
| Construction et réparation de bateaux | 10 | 812 | |
| Construction et réparation de bateaux | 10 | 812 | |
| Transports par voie d’eau | 16 | 231 | |
| Transports par voie d’eau | 16 | 231 | |
| Ensemble des activités maritimes | 109 | 3 728 | |
| Industrie | 36 | 1 735 | |
| Industries extractives | 9 | 198 | |
| Industries alimentaires | 4 | 362 | |
| Industries chimiques et pharmaceutiques | 11 | 818 | |
| Autres industries manufacturières ; Fabrication, réparation et installation de machines et d'équipements | 12 | 357 | |
| Collecte et traitement des eaux usées, traitement des déchets | 8 | 230 | |
| Collecte et traitement des eaux usées, traitement des déchets | 8 | 230 | |
| Services aux entreprises | 91 | 837 | |
| Commerce | 32 | 264 | |
| Logistique | 26 | 246 | |
| Ingénierie | 13 | 83 | |
| Autres services aux entreprises | 20 | 244 | |
| Transports terrestres | 30 | 1 529 | |
| Transports terrestres | 30 | 1 529 | |
| Ensemble des activités non maritimes | 165 | 4 331 | |
| Ensemble des activités du CIP | 274 | 8 059 | |
- Source : Insee, Flores 2017
En effet, il emploie 1,2 % des salariés de la Gironde, une part légèrement supérieure à celle du complexe de La Rochelle (0,9 %) mais bien moins importante qu’au Havre et à Marseille (5 %) ou encore à Nantes Saint-Nazaire et Rouen (4 %). Dans ces autres CIP, la contribution à la richesse produite est nettement plus importante que la contribution à l’emploi, du fait de la présence d’activités à plus forte valeur ajoutée que la moyenne. À Bordeaux, la richesse dégagée par les entreprises, estimée à 609 millions d’euros, contribue à 1,7 % de la richesse globale du département.
Des retombées économiques locales notables
En revanche, le trafic de marchandises du CIP de Bordeaux génère 1,1 emploi par tonne transitée, contre 0,6 en moyenne. Comme dans les autres ports estuariens tels que Nantes ou Rouen, la tonne passant par le port de Bordeaux est davantage transformée par des industries proches du port. Elle contribue ainsi aux retombées économiques directes locales, à l’inverse de CIP spécialisés dans la logistique desservant d’autres régions françaises, adossés généralement à des ports de façade maritime.
De plus, dans certaines communes girondines, le poids de l’activité portuaire dans l’emploi local s’avère très important. À Bassens, un lien fort d’interdépendance relie la commune et le port : principal lieu d’implantation des activités portuaires, Bassens regroupe près de 40 % des emplois du complexe. Ces emplois représentent 62 % de l’ensemble des emplois de la commune, ce qui en fait la commune la plus dépendante de l’activité portuaire. De même au Verdon-sur-Mer et à Ambès, les emplois locaux sont fortement dépendants (respectivement 40 % et 23 % des emplois salariés de la commune), même si ces communes ont un poids limité dans l’activité du port. Toutefois, trois communes, Bassens, Bordeaux et Bruges, concentrent à elles seules les deux tiers de ces établissements et 71 % de l’emploi salarié du CIP (figure 3). Avec 3 200 emplois, Bassens contribue pour un tiers à la richesse dégagée par le port. Suivent ensuite les communes de Bordeaux et de Bruges avec l’accueil respectif de 1 400 et 1 100 emplois du CIP.
tableauFigure 3 – Contribution des communes à l’emploi du CIP de Bordeaux et poids du CIP dans l’emploi de la commune
| Commune | Part de la commune dans le CIP (en %) | Part du CIP dans la commune (en %) | Nombre d’emplois |
|---|---|---|---|
| Bassens | 39,6 | 62,1 | 3 195 |
| Bordeaux | 17,5 | 0,7 | 1 411 |
| Bruges | 13,6 | 9,1 | 1 096 |
| Tresses | 4,7 | 12,4 | 377 |
| Ambès | 3,6 | 22,9 | 293 |
| Blanquefort | 3,4 | 2,9 | 278 |
| Mérignac | 3,2 | 0,4 | 256 |
| Saint-Loubès | 2,8 | 5,3 | 227 |
| Lormont | 2,1 | 1,9 | 170 |
| Ambarès-et-Lagrave | 1,9 | 3,8 | 155 |
| Le Verdon-sur-Mer | 1,7 | 40,2 | 138 |
| Reste des communes | 5,9 | 0,4 | 463 |
- Lecture : La commune de Bassens concentre 40 % des emplois du CIP de Bordeaux. Ces 3 200 emplois portuaires représentent 62 % de l’ensemble des emplois de la commune.
- Source : Insee, Flores 2017
graphiqueFigure 3 – Contribution des communes à l’emploi du CIP de Bordeaux et poids du CIP dans l’emploi de la commune

- Lecture : La commune de Bassens concentre 40 % des emplois du CIP de Bordeaux. Ces 3 200 emplois portuaires représentent 62 % de l’ensemble des emplois de la commune.
- Source : Insee, Flores 2017
Une répartition assez équilibrée des activités maritimes et non maritimes
Les activités maritimes et portuaires constituent le cœur de métier d’un port. Elles comprennent les établissements en lien direct avec la gestion portuaire, l’organisation des transports, la construction maritime et navale, ainsi que les transports par voie d’eau. En 2017, les activités maritimes sont exercées au sein de 109 établissements et occupent 3 700 salariés, soit 46 % des emplois du CIP. Plus de la moitié de ces derniers sont en lien direct avec le trafic de marchandises : organisation des transports, activités d’affrètement et d’organisation du transport et de la logistique, de fret express, de messagerie ou encore de manutention portuaire.
Tirant parti des infrastructures portuaires, des activités non maritimes sont également implantées dans le CIP. Représentant 4 400 emplois, elles relèvent principalement de l’industrie à 40 % et des transports terrestres à 35 %. Cet équilibre entre activités maritimes et non maritimes distingue le CIP de Bordeaux de ports comme Nantes ou Rouen, dont les trois quarts des salariés occupent des emplois non maritimes.
L’industrie liée au port de Bordeaux, avec ses 1 700 emplois, se caractérise par une forte prédominance du secteur de la chimie : des sites industriels permettant, par exemple, la fabrication d’élastomères synthétiques nécessaires à la confection des pneumatiques, ou encore d’huiles végétales raffinées, de biodiesel et de glycérine végétale, sont implantés sur le site de Bassens, tandis qu’une usine produit des engrais à Ambès. À ce titre, le site d’Ambès est référencé sur le plan national comme plateforme économique dédiée aux énergies et à la chimie reconnue dans le cadre de l’élaboration des plans de prévention des risques technologiques : cette reconnaissance lui permet de bénéficier d’un accompagnement spécifique en matière de culture de la sécurité. Globalement, du fait de cette présence marquée d’activités industrielles à forte valeur ajoutée, les deux tiers de la richesse dégagée par le CIP sont générées par les activités non maritimes alors qu’elles occupent à peine plus de la moitié des emplois.
Le port de Bordeaux se positionne ainsi comme un complexe de transformation industrielle et également d’organisation des transports de marchandises. À Bassens, les emplois du CIP sont davantage ancrés dans le non-maritime (sept emplois sur dix) et plus précisément dans l’industrie et les transports terrestres (respectivement 32 % et 21 % des emplois). À l’inverse de Bassens, les emplois du CIP situés à Bordeaux et Bruges sont davantage tournés vers la construction navale et l’organisation des transports : le site de Bordeaux dispose aussi d’une spécialisation dans les activités de construction et réparation de bateaux, avec notamment un site industriel majeur de production de catamarans de plaisance, le plus gros employeur du CIP, et celui de Bruges est tourné vers l’organisation des transports.
Un tissu productif à dimension internationale et des centres de décision français
Le tissu productif du CIP de Bordeaux se caractérise par une forte présence des grandes entreprises (GE) et des entreprises de taille intermédiaire (ETI) qui rassemblent 90 % de l’emploi salarié, contre la moitié dans le reste de la Gironde. Les ETI prédominent, surtout dans le maritime. Néanmoins, davantage présentes dans le non-maritime, les GE concentrent notamment la moitié des emplois de l’industrie. À l’opposé, les PME et micro-entreprises, bien moins présentes sur le port, abritent quatre fois moins d’emplois que celles du reste de la Gironde. Les groupes occupent une place importante dans l’économie portuaire et contrôlent la quasi-totalité des emplois du CIP (figure 4).
tableauFigure 4 – Répartition des emplois selon l’origine du groupe et le centre de décision en 2017
| CIP | Gironde (hors CIP) | Part des emplois du CIP dépendants d’un centre de décision régional | Part des emplois de la Gironde (hors CIP) dépendants d’un centre de décision régional | |
|---|---|---|---|---|
| Entreprise indépendante française | 4,3 | 31,5 | 4,3 | 29,8 |
| Groupe franco-français | 24,7 | 25,1 | 19,4 | 19,4 |
| Multinationale française | 55,9 | 36,1 | 12,3 | 2,5 |
| Groupe étranger | 15,1 | 7,4 | 0,0 | 0,0 |
- Lecture : 56 % des emplois du CIP dépendent d’une multinationale française et 12 % d’une multinationale française sous contrôle régional.
- Source : Insee, Lifi 2017
graphiqueFigure 4 – Répartition des emplois selon l’origine du groupe et le centre de décision en 2017

- Lecture : 56 % des emplois du CIP dépendent d’une multinationale française et 12 % d’une multinationale française sous contrôle régional.
- Source : Insee, Lifi 2017
Parmi eux, les multinationales, françaises ou étrangères, emploient près des trois quarts des salariés, bien plus que dans le reste de la Gironde (43 %) ou qu’en France métropolitaine (47 %). D’ailleurs, les emplois du complexe sont deux fois plus souvent dépendants de centres de décision localisés à l’étranger que dans le reste du département.
Toutefois, bien qu’à dimension internationale, le contrôle des emplois du port n’en reste pas moins français pour plus de huit emplois sur dix. En revanche, ces emplois relèvent plus souvent d’un centre de décision extérieur à la région : 20 % des emplois du complexe sont notamment sous contrôle francilien. Cette dépendance est liée à la structure même du tissu productif du complexe, et en particulier à la faible présence d’entreprises indépendantes dont le centre de décision est souvent régional. En revanche, lorsqu’ils sont contrôlés par des multinationales françaises, les emplois du CIP relèvent plus souvent d’un centre de décision néo-aquitain que ceux du reste de la Gironde.
Un milieu ouvrier, très masculin
La nature des activités portuaires rejaillit sur le profil des salariés du CIP qui s’écarte assez nettement de la moyenne départementale. Ainsi, au sein du CIP, la moitié des salariés sont des ouvriers, quasiment tous qualifiés, soit près de deux fois plus que dans le reste de la Gironde. À l’inverse, comparés au département toujours, les employés sont trois fois moins nombreux dans le CIP, et surtout présents dans les « services aux entreprises » et « l’organisation des transports ». Seule la proportion de cadres est identique à celle du reste du département. La plus grande part des postes de cadres observée dans les activités maritimes est liée à la présence du secteur de « gestion du port » qui emploie deux fois plus de cadres par rapport à la moyenne du CIP.
Corollaire de la surreprésentation ouvrière dans l’emploi, les hommes sont largement majoritaires au sein du CIP. Ils occupent les trois quarts des postes salariés, contre à peine la moitié dans le reste de la Gironde. Cette masculinisation est encore plus prégnante dans le domaine non maritime
Des emplois plus stables et des rémunérations attractives
De façon générale, les emplois du CIP profitent de formes d’emploi plus stables et de rémunérations plus élevées que dans le reste de la Gironde. Les contrats y sont plus souvent à durée indéterminée et à temps complet, notamment dans les activités non maritimes. Dans le maritime, les « transports par voie d’eau » affichent le plus fort taux de CDD (26 %) du fait de la saisonnalité de l’activité avec les navettes de passagers entre Le Verdon-sur-Mer et Royan ainsi qu’entre Blaye et Lamarque. Avec 14,5 euros nets de l’heure contre 12,1 euros, soit un différentiel de 20 %, les entreprises du CIP offrent de meilleures rémunérations que celles du reste de la Gironde. À catégorie socioprofessionnelle équivalente, l’écart de rémunération est toujours en faveur du CIP, et encore plus pour les cadres et professions intellectuelles supérieures. En lien avec de nombreux cadres dans le secteur de la « gestion du port », les postes du maritime profitent de salaires supérieurs à ceux du non-maritime (15,2 euros nets de l’heure contre 14 euros).
Des trajets domicile-travail plus longs
Près de 2 400 salariés du CIP de Bordeaux résident dans une commune située en dehors du département de la Gironde, une spécificité inhérente aux activités d’organisation des transports et aux transports terrestres.
En dehors de ces deux secteurs d’activités, 90 % des salariés n’habitent pas la commune dans laquelle ils travaillent, une proportion supérieure de 13 points à celle du reste de la Gironde. Cette situation occasionne de nombreuses navettes domicile-travail, sur des trajets d’ailleurs plus longs en distance et en durée : la moitié des salariés du port parcourent au moins 18,5 km pour se rendre sur leur lieu de travail, contre 11,3 km pour les autres salariés girondins. L’écart en temps de trajet est moindre, avec une durée médiane de 24 minutes en heures pleines contre 20 minutes. Pour les salariés travaillant sur les sites de Bordeaux et du Verdon-sur-Mer, ces trajets s’allongent encore.
Encadré - Port de Bordeaux, acteur de la transition du territoire néo-aquitain
Acteurs de développement des territoires, les ports sont des lieux privilégiés d’échanges de marchandises et d’implantations d’activités industrielles et logistiques. La crise sanitaire mondiale liée à la Covid-19 montre à quel point ils constituent un actif stratégique indispensable à l’activité économique de notre pays et de nos régions.
Les solutions et services portuaires, dont ceux proposés par le port de Bordeaux et l’ensemble du complexe industrialo-portuaire (CIP), contribuent également à la réussite des transitions long terme des territoires, qu’elles soient écologiques, énergétiques, économiques ou encore sociales. La nécessité de réorienter le modèle portuaire vers une économie décarbonée et protectrice de la biodiversité apparaît ainsi clairement comme l’objectif des années à venir. Ce modèle portuaire en devenir constitue une nouvelle grille de lecture à l’aide de laquelle les activités traditionnelles d’un port doivent être réinterprétées, telles que l’aménagement du domaine portuaire, la gestion des accès nautiques, la réalisation et l’entretien des infrastructures, l’aménagement de zones d’activités et la promotion du port, ou, de manière plus générale, la recherche de valeur et le développement de l’emploi.
Ce sont ainsi quatre grands défis stratégiques portuaires que devront relever le port, sa communauté portuaire et ses partenaires :
- Replacer l’interface portuaire au centre des échanges régionaux : soutenir une logistique agile, sobre et performante.
- Inscrire le renouvellement du modèle économique portuaire dans les transitions écologiques et énergétiques : la décarbonation comme levier de réindustrialisation de l’écosystème portuaire.
- Soutenir un écosystème portuaire au service du territoire : rechercher des relais de croissance dans un monde en transition écologique et énergétique.
- Faire la ville sur le port, et le port sur la ville : valoriser l’identité portuaire comme marqueur du territoire.
La déclinaison d’une partie de la réponse à ces défis, celle du Grand Port Maritime de Bordeaux, sera précisée pour les 5 prochaines années dans son nouveau projet stratégique (2021-2025), actuellement en cours de finalisation.
Pour comprendre
La méthodologie est inspirée de celle utilisée par la Banque nationale de Belgique pour les ports de commerce flamands. Elle est cohérente avec celle utilisée par l’Insee pour l’analyse des ports de La Rochelle, Nantes Saint-Nazaire et de l’alliance HAROPA (Grands ports maritimes du Havre et de Rouen, Ports de Paris).
Ainsi, l’ensemble des unités productives liées au Grand Port Maritime de Bordeaux (GPMB) est sélectionné sur la base de l‘activité principale à partir de la définition d’un corpus commun à l’ensemble des équipements portuaires, et/ou de leur situation géographique au sein de la zone industrialo-portuaire (ZIP) définie par le GPMB.
Le GPMB abrite à la fois des activités maritimes et non maritimes de type complexe industrialo-portuaire (CIP), localisées dans la ZIP et en dehors.
Les établissements ayant une activité « cœur de métier » de construction et réparation de bateaux, d’organisation des transports, de gestion du port et de transports par voie d’eau ont été sélectionnés sur le périmètre de la Gironde. Les autres établissements sont pris sur la zone industrialo-portuaire. Sur décision conjointe du GPMB et de l’Insee, ces mêmes types d’établissements, situés à l’extérieur de la ZIP, sont inclus également s’ils dépendent fortement de l’économie portuaire et s’ils tirent avantage de façon décisive de l’activité portuaire.
Les établissements sans lien de dépendance avec les infrastructures du port et/ou l’activité portuaire, venus s’installer sur la ZIP pour bénéficier du foncier disponible, n’ont pas été pris en compte. L’emploi portuaire présenté dans l’étude correspond à l’ensemble des salariés des établissements sélectionnés.
Définitions
La richesse dégagée est une estimation de l’importance de l’activité économique d’un secteur ou d’une zone géographique, permettant de les comparer autrement que sous l’angle des emplois salariés. Elle correspond pour les entreprises multi-établissements, à la ventilation entre les établissements de la valeur ajoutée de l’entreprise au prorata des masses salariales, ce qui repose sur de fortes hypothèses de comparabilité des fonctions de production. La richesse dégagée n’a donc pas de signification au niveau individuel. Elle doit se limiter à des usages agrégés, en tenant compte des biais d’estimations associés.
Pour en savoir plus
Roger P., Silvestre E., « 47 200 salariés en 2017 dans les complexes industrialo-portuaires du Havre et de Rouen », Insee Flash Normandie n°101, avril 2021
Genebes L., « Le Grand Port Maritime de La Rochelle : des activités orientées vers la logistique », Insee Analyses Nouvelle-Aquitaine n°51, janvier 2018
Thioux E., « 15 600 emplois dans les principaux ports d’Île-de-France », Insee Analyses Île-de-France n° 65, septembre 2017
Besnard S., Coutard G., « 25 300 emplois salariés sur le complexe industrialo-portuaire de Nantes Saint-Nazaire », Insee Flash Pays de la Loire n°102, juillet 2020