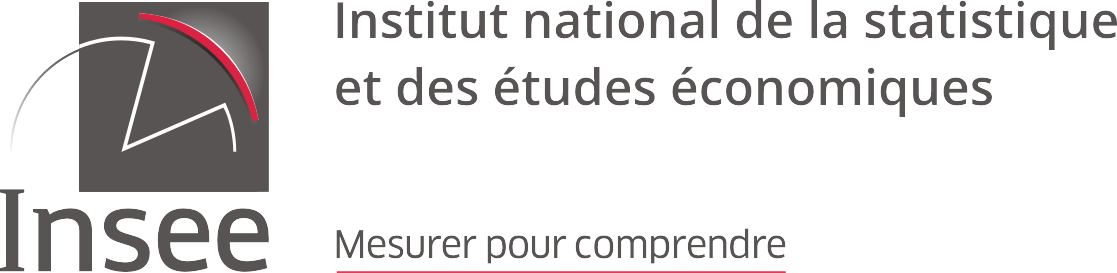Toulouse et Montpellier : un rôle structurant dans la démographie de la nouvelle région depuis 50 ans
D’un exode rural dans les années 60 à un étalement urbain sur de vastes zones périurbaines aujourd’hui, la dynamique démographique de Languedoc-Roussillon - Midi-Pyrénées a profondément changé. Les grandes agglomérations sont les moteurs de la croissance démographique au cours des décennies récentes, avec l’arrivée de nombreux habitants et une concentration de l’excédent naturel. Leurs influences s’étendent toujours plus loin dans l’espace rural, constituant de grandes aires urbaines qui structurent le territoire.
Languedoc-Roussillon - Midi-Pyrénées est la plus attractive des nouvelles régions françaises. Cela n’était pas le cas il y a 50 ans, puisqu’elle perdait alors plus d’habitants qu’elle n’en gagnait au jeu des migrations. Ce regain d’attractivité porte principalement sur les adultes âgés de 18 à 39 ans, qui quittaient massivement la région, alors qu’ils sont désormais nombreux à s’y installer. Les jeunes de 18 à 24 ans migrent surtout en Haute-Garonne et dans l’Hérault, les métropoles de Toulouse et Montpellier concentrant l’offre d’enseignement supérieur dans la région.
- Une structuration du territoire en grandes aires urbaines
- Aujourd’hui, l’étalement urbain se poursuit
- L’excédent naturel se concentre aujourd’hui dans les grandes aires urbaines
- D’un déficit migratoire avec les autres régions…
- …au plus fort excédent de France
- Un renversement de tendance pour les jeunes adultes
- Les départements : dans le sillage des grandes aires urbaines
Dans les années 60, la croissance démographique dans la région Languedoc-Roussillon - Midi-Pyrénées (LRMP) est concentrée dans les agglomérations et le long de la côte méditerranéenne. Les principales agglomérations (les pôles urbains des 24 grandes aires urbaines actuelles) connaissent alors une croissance démographique de 3 % par an. Mais les autres agglomérations, de tailles plus modestes, entretiennent également une croissance soutenue (+ 1,3 % par an), concentrée dans les villes-centres.
Le contraste avec les zones rurales est important : si les communes proches des grandes agglomérations sont en légère croissance, la population chute aussi bien dans les communes proches des agglomérations plus petites (- 1 %) que dans les communes isolées (- 1,1 %).
graphiqueFigure_1 – La population de la Haute-Garonne et de l’Hérault a plus que doublé en 50 ans

- Source : Insee, recensements de la population 1962à 2012
Une structuration du territoire en grandes aires urbaines
Dans les années 80, la situation est différente : les villes-centres gagnent peu d’habitants, voire en perdent. La croissance démographique des agglomérations est désormais portée par les banlieues, avec un dynamisme particulièrement fort pour les banlieues des grands pôles urbains (+ 2,6 % par an).
Par ailleurs, de vastes zones rurales sous l’influence des agglomérations gagnent de nombreux habitants : les couronnes périurbaines se développent à un rythme rapide (+ 1,9 %).
La zone d’influence de Toulouse couvre un territoire toujours plus étendu. La côte méditerranéenne continue à croître fortement. De grandes aires urbaines, avec une influence au-delà des seules agglomérations, émergent avec le développement des banlieues et des couronnes périurbaines.
graphiqueFigure_2 – Une croissance démographique qui se diffuse



- Source : Insee, recensements de la population
Aujourd’hui, l’étalement urbain se poursuit
Sur la période récente, la croissance démographique s’étale encore plus sur le territoire. Les couronnes périurbaines continuent à se développer rapidement (+ 1,7 % par an entre 2007 et 2012), alors que la population des banlieues augmente désormais moins vite.
Autour de Toulouse, la croissance est forte sur une grande zone qui s’étend jusqu’aux villes proches sous son influence (Montauban, Albi, Pamiers, Auch, Saint-Gaudens, Carcassonne). Le long de la côte méditerranéenne, la croissance démographique s’accélère à l’intérieur des terres.
Dans l’espace rural hors influence des agglomérations, la population est stable depuis les années 2000. Les zones continuant à perdre des habitants sont essentiellement des zones difficiles d’accès, moins bien desservies par les grands axes de circulation (les Pyrénées, les Causses, le Haut-Languedoc…).
Entre le développement des couronnes périurbaines et la stabilisation des communes isolées, plus de la moitié de la croissance démographique de la région est portée par les communes rurales.
L’excédent naturel se concentre aujourd’hui dans les grandes aires urbaines
Dans les années 60, la baisse démographique des communes rurales est surtout le fait d’un exode rural, avec le départ de nombreux habitants vers les villes. A contrario le solde naturel contribue peu à ce déclin : il est souvent proche de zéro. Quant aux agglomérations, leur population augmente fortement par le cumul de deux effets : d’une part de nombreux nouveaux habitants s’y installent, d’autre part les naissances sont supérieures aux décès.
Sur la période récente les phénomènes sont bien différents, avec la structuration du territoire autour de grandes aires urbaines. L’excédent naturel est concentré dans ces grandes aires urbaines, plus jeunes que le reste du territoire. Les aires de Toulouse et Montpellier se démarquent même nettement, avec un accroissement naturel supérieur à 0,6 %. Beaucoup de nouveaux habitants s’y installent également, mais ce sont surtout les zones périurbaines, plus que les agglomérations, qui bénéficient d’un excédent migratoire important.
Sur le reste du territoire les décès sont généralement plus nombreux que les naissances, du fait d’une population plus âgée. Les communes rurales hors influence des grandes agglomérations, mais bien desservies par les grands axes de circulation, bénéficient elles aussi de l’installation de nouveaux habitants.
Le solde migratoire régional croît fortement jusqu’en 1982, puis se stabilise
tableauFigure_5 – Solde migratoire annuel avec la France métropolitaine (pour 1000 habitants)
| Ensemble (9 ans ou plus) | 9-17 ans | 18-24 ans | 25-39 ans | 40-59 ans | 60-74 ans | 75 ans ou plus | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1962-1968 | -0,4 | 1,9 | -7,9 | -3,4 | 1,6 | 2,3 | 1,1 |
| 1968-1975 | 1,9 | 5,2 | -2,5 | -2,9 | 3,9 | 4,1 | 1,8 |
| 1975-1982 | 5,7 | 8,9 | 4,1 | 5,8 | 5,9 | 6 | 1,6 |
| 1982-1990 | 5,7 | 8,2 | 6,5 | 4 | 6,3 | 6,9 | 1,7 |
| 1990-1999 | 5,6 | 7,9 | 7,6 | 4,4 | 6,1 | 6,4 | 1,7 |
| 2003-2008 | 5,9 | 7,3 | 8,3 | 5,6 | 6,2 | 7 | 1,4 |
- Sources : Insee, recensements de la population 1968, 1975, 1982, 1990, 1999, 2008
graphiqueFigure_5 – Solde migratoire annuel avec la France métropolitaine (pour 1000 habitants)

- Sources : Insee, recensements de la population 1968, 1975, 1982, 1990, 1999, 2008
Un excédent migratoire avec toutes les régions française depuis 30 ans
tableauFigure_6 – Solde migratoire annuel de Languedoc-Roussillon-Midi-Pyrénées avec les nouvelles régions métropolitaines
| Île-de-France | Autres régions métropolitaines | PACA | Nord - Pas-de-Calais - Picardie | Auvergne - Rhône-Alpes | Alsace - Champagne-Ardennes - Lorraine | Aquitaine - Limousin - Poitou-Charentes | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1962-1968 | -934 | 727 | -841 | 481 | -1396 | 412 | 424 |
| 1968-1975 | 2325 | 1782 | -1395 | 1532 | 192 | 1323 | 728 |
| 1975-1982 | 7987 | 3402 | 1521 | 2425 | 2363 | 2338 | 1005 |
| 1982-1990 | 6861 | 4523 | 2223 | 2975 | 2335 | 2621 | 1654 |
| 1990-1999 | 9504 | 4546 | 2191 | 2728 | 2567 | 2027 | 1257 |
| 2003-2008 | 9857 | 5370 | 4410 | 3799 | 2741 | 2724 | 1008 |
- Sources : Insee, recensements de la population 1968, 1975, 1982, 1990, 1999, 2008
graphiqueFigure_6 – Solde migratoire annuel de Languedoc-Roussillon-Midi-Pyrénées avec les nouvelles régions métropolitaines

- Sources : Insee, recensements de la population 1968, 1975, 1982, 1990, 1999, 2008
D’un déficit migratoire avec les autres régions…
Entre 1962 et 1968, la région perd des habitants dans les échanges migratoires avec les autres régions métropolitaines (- 0,4 ‰ par an). Ce déficit migratoire est surtout dû au départ des jeunes âgés de 18 à 39 ans, qui quittent massivement la région pour des régions plus attractives. Seuls la Haute-Garonne et l’Hérault gagnent plus de jeunes qu’ils n’en perdent au jeu des migrations. L’Île-de-France, Rhône-Alpes-Auvergne et PACA sont les principales destinations des habitants de la région. PACA est alors largement la région la plus attractive de France (+ 4,7 ‰).
La situation s’améliore largement jusqu’à la fin des années 70, puisque la région connaît alors un fort excédent migratoire (+ 5,7 ‰ par an entre 1975 et 1982). Seules PACA (+ 7,1 ‰) et la Corse (+ 7,2 ‰) demeurent plus attractives. Languedoc-Roussillon-Midi-Pyrénées devient excédentaire dans ses échanges avec toutes les autres régions (y compris PACA et Corse).
Cette amélioration s’explique principalement par le fort retournement de tendance vis-à-vis des jeunes : la région attire désormais aussi bien les étudiants que les jeunes adultes cherchant à travailler. Mais la région attire également de plus en plus de personnes âgées de 40 ans ou plus, en particulier celles en fin de carrière ou en début de retraite.
…au plus fort excédent de France
Depuis 1999, LRMP est désormais la plus attractive de toutes les régions françaises. En effet si son excédent migratoire évolue peu (+ 5,9 ‰ entre 2003 et 2008), dans le même temps celui de PACA chute (+ 1 ‰), et celui de la Corse se tasse (+ 5,2 ‰). La nouvelle région attire notamment des habitants de tous âges.
Ce sont désormais dans ses échanges avec l’Île-de-France et PACA que Languedoc-Roussillon-Midi-Pyrénées gagne le plus d’habitants.
Un renversement de tendance pour les jeunes adultes
L’inversion de tendance est remarquable pour les jeunes de 18 à 24 ans : alors qu’ils sont ceux qui quittent le plus la région dans les années soixante (- 7,9 ‰ par an entre 1962 et 1968), ils sont maintenant ceux qui s’y installent le plus (+ 8,3 ‰ par an entre 2003 et 2008). À l’intérieur de la région la situation est cependant contrastée : la Haute-Garonne et l’Hérault sont aujourd’hui les seuls départements avec un excédent migratoire de jeunes de 18 à 24 ans. Ces deux départements attirent en particulier les jeunes du reste de la région, en concentrant à Toulouse et Montpellier les établissements d’enseignement supérieur de la région.
Pour les personnes âgées de 25 à 39 ans (essentiellement des jeunes actifs), le changement de tendance est également marqué, avec le passage d’un déficit migratoire (- 3,4 ‰ entre 1962 et 1968) à un excédent (+ 5,6 ‰ entre 2003 et 2008). Mais surtout, c’est la répartition des migrations à l’intérieur de la région qui est en rupture. Dans les années 60, seuls la Haute-Garonne et l’Hérault gagnent des habitants de cette tranche d’âge. Sur la période récente, tous les autres départements attirent désormais des jeunes actifs, alors que la Haute-Garonne et l’Hérault sont les seuls à en perdre. Après avoir fini leurs études à Toulouse ou Montpellier, beaucoup de jeunes s’en vont pour, vraisemblablement, chercher un travail dans un autre département. Il y a également l’influence de la périurbanisation, qui déborde au-delà de la Haute-Garonne sur les départements voisins, et au delà de l’Hérault sur le Gard : des jeunes actifs travaillant à Toulouse et Montpellier s’installent désormais dans d’autres départements.
graphiqueFigure_7_8 – Un apport migratoire qui s’amplifie sur la majorité du territoire

- Source : Insee, recensements de la population
graphiqueFigure_9 – Un excédent naturel qui se concentre dans les grandes aires urbaines


- Source : Insee, recensements de la population
Les départements : dans le sillage des grandes aires urbaines
Les départements de la Haute-Garonne et de l’Hérault sont les plus dynamiques de la nouvelle région, avec une population qui a plus que doublé entre 1962 et 2012. D’une part l’excédent migratoire reste parmi les plus élevés de la région sur toute cette période. D’autre part la population qui arrive est plus jeune que dans les autres départements, attirée notamment par l’offre en termes d’enseignement supérieur ou d’emploi à Toulouse et Montpellier. Contrairement au reste de la région, l’excédent naturel y est plus fort aujourd’hui qu’il ne l’était 50 ans auparavant.
Les Pyrénées-Orientales (+ 1,2 % par an) et le Gard (+ 1,0 %) ont également une croissance démographique supérieure à la moyenne régionale (+ 0,9 %). Le développement des aires urbaines de Perpignan et de Nîmes, les plus importantes de la région après Toulouse et Montpellier, conduisent à ces rythmes élevés grâce à un excédent migratoire important. Mais contrairement à la Haute-Garonne et l’Hérault, l’attractivité s’exerce moins sur les jeunes, si bien que le solde naturel se dégrade avec le vieillissement de la population.
La croissance démographique de l’Aude et du Tarn-et-Garonne accélère à partir des années 80 (+ 0,9 % par an chacun depuis 1982) : l’excédent migratoire y est en forte progression et le déficit naturel en nette réduction. La croissance du Tarn-et-Garonne est désormais tirée par un nombre de naissances bien supérieur aux décès, favorisée par l’installation massive de jeunes en âge d’avoir des enfants : entre 2003 et 2008 ce département gagne plus de 1 000 habitants âgés de 25 à 39 ans au jeu des migrations ce qui, proportionnellement à la population présente, représente le nombre le plus élevé de toute la France.
La population de l’Aveyron et de la Lozère, départements très ruraux, baisse jusque dans les années 90, impactée à la fois par l’exode rural et un déficit naturel. Mais depuis les années 2000, la population repart à la hausse : l’installation de nouveaux habitants permet en effet de compenser le déficit de naissances. Ces deux départements ont cependant toujours moins d’habitants en 2012 qu’en 1962 (- 5 %).
Pour les autres départements (Gers, Tarn, Ariège, Lot, Hautes-Pyrénées), la situation se ressemble : le nombre d’habitants reste plutôt stable jusqu’aux années 90. Mais la population repart désormais à la hausse grâce à un excédent migratoire en progression, à l’exception des Hautes-Pyrénées, dont la population stagne toujours.
Définitions
Le solde migratoire est la différence entre le nombre d’entrants et le nombre de sortants du territoire étudié. Comme les flux de personnes parties résider dans un pays étranger ne sont pas connus, ce solde n’est calculé que pour les flux avec la France métropolitaine. Ce solde ne prend notamment pas en compte les arrivées en France des rapatriés d’Algérie entre 1962 et 1968.
Le solde migratoire apparent est estimé par différence entre la variation totale de la population et le solde naturel. Il peut être différent du solde migratoire du fait des imprécisions tenant aux défauts de comparabilité entre deux recensements (évolutions de concepts de population et qualité inégale). Il est qualifié de solde migratoire « apparent », afin que l’utilisateur garde en mémoire la marge d’incertitude qui s’y attache. Ce solde prend en compte les arrivées en France des rapatriés d’Algérie entre 1962 et 1968.
Une unité urbaine est une commune ou un ensemble de communes qui comporte sur son territoire une zone bâtie d’au moins 2 000 habitants où aucune habitation n’est séparée de la plus proche de plus de 200 mètres. C’est la notion connue d’agglomération. Elle est constituée de la ville-centre et de sa banlieue. Un grand pôle urbain est une unité urbaine qui offre au moins 10 000 emplois.
Une grande aire urbaine est la zone d’influence d’une ville en termes d’emplois. C’est un ensemble de communes constitué par un grand pôle urbain et par des communes rurales ou des unités urbaines dont au moins 40 % de la population résidante ayant un emploi travaille dans le pôle ou dans des communes attirées par celui-ci (couronne périurbaine).
Pour en savoir plus
« Languedoc-Roussillon et Midi-Pyrénées : le grand sud attractif », Insee Analyses Midi-Pyrénées n°16, avril 2015
« Union des régions Languedoc-Roussillon et Midi-Pyrénées : 5,6 millions d’habitants », Insee Flash Languedoc-Roussillon n°9, janvier 2015
« Trente ans de démographie des territoires - Le rôle structurant du Bassin parisien et des très grandes aires urbaines », Insee Première n°1482, janvier 2014