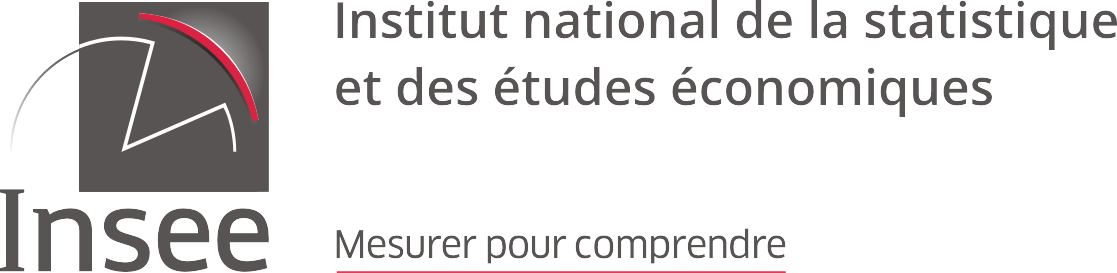Innovation en Nord-Pas-de-Calais : des capacités à exploiter
Entre 2010 et 2012, près d'une PME sur deux a été innovante en Nord-Pas-de-Calais. Le taux d'innovation des entreprises régionales reste toutefois en retrait par rapport à la France de province. Depuis 2008, la part de l'innovation technologique s'est réduite, sous l'effet notamment de la crise économique de 2008-2009. L'innovation s'accompagne le plus souvent de partenariats, notamment publics, et porte en majorité sur l'organisation de l'entreprise, en particulier au sein des unités tertiaires. Le soutien public joue un rôle important en matière d'innovation. Le Crédit d'impôt recherche et l'autofinancement en sont les deux modes de financement privilégiés. Des capacités d'innovation dans les PME régionales restent inexploitées : les entreprises régionales innovent moins que le permettrait leur potentiel et pourraient davantage recourir aux aides publiques.
- Un taux d'innovation moindre en région Nord-Pas-de-Calais
- L'innovation : un processus cumulatif
- L'innovation d'organisation se maintient, contrairement à l'innovation technologique
- Le soutien financier public joue un rôle important en matière d'innovation
- Crédit d'impôt recherche et autofinancement : deux modes de financement privilégiés
- Des collaborations nombreuses, réalisées avec des partenaires de proximité
- Méthodologie
Entre 2010 et 2012, près d'une PME nordiste sur deux, intervenant dans les secteurs de l'industrie et des services intellectuels et technologiques, a mené une activité d'innovation (figure 1). Celle-ci peut prendre des formes différentes. Dans son acception la plus large, elle inclut l'ensemble des formes d'innovations, qu'elles soient technologiques (développement de nouveaux produits ou procédés) ou non technologiques (du domaine de l'organisationnel ou du marketing) (définitions).
Le taux d'innovation, c'est-à-dire la proportion d'entreprises innovantes, varie selon la taille de l'entreprise et le secteur d'activités. En Nord-Pas-de-Calais comme en France, la propension à l'innovation est plus prononcée au sein des entreprises de grande taille. Ainsi, en 2012, près de 68 % des structures nordistes de plus de 50 salariés sont innovantes, contre 43 % pour celles de 10 à 20 salariés (figure 2). D'autre part, les PME du secteur de l'information et de la communication sont plus innovantes que celles des autres secteurs.
Les entreprises innovantes présentent généralement des indicateurs de « bonne santé » économique plus favorables. Leur chiffre d'affaires et leur propension à exporter sont plus élevés. Elles emploient une proportion plus grande de cadres et versent des salaires plus élevés.
graphiqueFigure 1 – Un écart marqué avec la France de province

- Note de lecture : entre 2010 et 2012, 49 % des entreprises régionales ont été innovantes ; elles étaient 48 % dans le domaine de l’industrie et de l’énergie, et 55 % dans celui des services. Remarque : la notion de France de province inclut ici les DOM.
- Source : Insee, enquête CIS 2012, champ des entreprises mono et quasi monorégionales de moins de 250 salariés
tableaufigure 2 – Taille et secteur d'activités : des déterminants essentiels de la propension à innover
| Innovation au sens large | Innovation technologique | Produits | Procédés | Organisation | Marketing | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nord-Pas-de-Calais | France de Province | Nord-Pas-de-Calais | France de Province | Nord-Pas-de-Calais | ||||
| Effectif salarié | ||||||||
| Moins de 20 salariés | 43 | 47 | 31 | 33 | 17 | 21 | 24 | 17 |
| De 20 à 49 salariés | 47 | 57 | 33 | 42 | 21 | 23 | 34 | 19 |
| De 50 à 249 salariés | 68 | 74 | 56 | 62 | 41 | 34 | 41 | 29 |
| Secteur | ||||||||
| Industrie manufacturière / Energie | 48 | 54 | 37 | 41 | 22 | 25 | 29 | 18 |
| Information et communication | 62 | 69 | 46 | 54 | 37 | 24 | 41 | 32 |
| Activités spécialisées, scientifiques et techniques | 50 | 61 | 30 | 42 | 20 | 19 | 36 | 23 |
| Total | 49 | 56 | 37 | 42 | 23 | 24 | 31 | 20 |
- Remarque : Réponse multiple possible.
- Source : Insee, enquête CIS 2012, champ des entreprises mono et quasi-monorégionales de moins de 250 salariés.
Un taux d'innovation moindre en région Nord-Pas-de-Calais
Le taux d'innovation des PME du Nord-Pas- de-Calais est sensiblement plus faible que celui des PME de France de province. L'écart est de sept points pour l'innovation au sens large et de cinq points pour l'innovation technologique (figure 1 ).
Plusieurs facteurs sont traditionnellement mis en avant pour expliquer les différences de comportement d'innovation entre les entreprises et, plus largement, entre les régions : taille de l'entreprise, secteur d'activité, taux d'investissement, taux d'exportation, part des ingénieurs dans les emplois de l'entreprise. Pour tous ces éléments, les PME régionales ne se distinguent pas nettement de leurs homologues de province. Le Nord-Pas-de-Calais présente par exemple une proportion d'entreprises appartenant aux secteurs dits innovants, selon la nomenclature de l'OCDE (définitions), similaire à celle de la France de province, avec environ 10 % d'entreprises concernées, de tailles elles-mêmes comparables aux autres caractéristiques régionales. Or ces unités présentent une moindre propension à l'innovation. L’écart observé entre le taux d’innovation des entreprises nordistes et celui des entreprises situées dans les autres régions de province ne s'explique donc pas par un tissu productif peu propice à l'innovation. Il résulterait davantage du comportement d'innovation spécifique des entreprises de la région, qui innovent moins que le permettrait leur potentiel.
Par ailleurs, l'innovation n'a pas augmenté de manière significative entre 2010 et 2012 par rapport à la période 2006-2008. Les entreprises présentes en 2008 et 2012 (méthodologie) n'enregistrent pas d'évolution significative de leur taux d'innovation. Environ 53 % d'entre elles étaient innovantes, que ce soit en 2008 ou en 2012. La proportion reste également stable en matière d'innovation technologique, avec un taux d'innovation proche de 49 %. Au niveau national, la part des entreprises innovantes a peu évolué de sorte que l'écart de taux d'innovation entre le Nord-Pas-de-Calais et la France de province ne s'est pas réduit.
L'innovation : un processus cumulatif
Deux tiers des entreprises qui innovaient déjà entre 2006 et 2008 gardent ce profil en 2012. De même, 58 % des entreprises technologiquement innovantes en 2008 le sont également en 2012. Ces entreprises appartiennent davantage au secteur de l'information et de la communication, globalement plus innovant.
Parallèlement, les entreprises non-innovantes entre 2006 et 2008 sont moins susceptibles d'innover en 2012. L'innovation étant un processus à long terme nécessitant des investissements quasi permanents, il est peu fréquent qu'une entreprise s'engage de manière transitoire dans ce type de projets. La crise économique de 2008-2009 a également pu freiner la mise en œuvre d'une stratégie d'innovation par les entreprises. Elle s'est notamment traduite par une réduction de la demande de biens et services. De plus, les contraintes de crédit et la réduction de leur capacité d'autofinancement ont pu limiter la capacité des PME à innover et à se réorganiser pendant la récession.
L'innovation d'organisation se maintient, contrairement à l'innovation technologique
L'innovation d'organisation est la forme d'innovation la plus présente au sein des entreprises régionales sur la période 2010-2012. Près de 31 % des entreprises régionales conduisent des innovations d'organisation (figure 2). Pour un quart d'entre elles, l'innovation a plus précisément porté sur l'organisation du travail et la répartition des responsabilités entre les salariés. La surreprésentation de ce type d'innovation se vérifie dans tous les domaines d'activité, avec une prédominance plus soutenue encore dans le tertiaire.
Les entreprises innovantes enquêtées à la fois en 2008 et en 2012 (méthodologie) ont un comportement d'innovation similaire à celui de l'ensemble des autres unités régionales : la part des différentes formes d'innovations mises en place est sensiblement la même (figure 3).
graphiqueFigure 3 – Une nette diminution de l’innovation technologique

- Note de lecture : entre 2010 et 2012, 49 % des entreprises régionales ont mis en place des innovations de procédés. Sur la même période, elles sont 47 % parmi le champ constant, contre 66 % sur celle allant de 2006 à 2008.
- Remarque : réponse multiple possible.
- Source : Insee, enquête CIS 2012, champ des entreprises technologiquement innovantes, mono et quasi monorégionales de moins de 250 salariés
Depuis 2008, consécutivement à la crise, les entreprises innovantes se sont moins engagées dans des innovations technologiques. Par exemple, environ deux tiers d'entre elles avaient développé des innovations de procédés sur la période 2006-2008, contre moins d'une sur deux en 2010-2012. Ce recul de l'innovation technologique s'est fortement opéré dans le domaine tertiaire, en particulier pour ce qui concerne les innovations de produits. En effet, les secteurs de haute technicité, tels que les services intellectuels et technologiques, sont généralement plus exposés aux fluctuations conjoncturelles.
Le soutien financier public joue un rôle important en matière d'innovation
Plus d'une entreprise technologiquement innovante sur deux a eu recours à au moins un mode de financement public (figure 4), une part qui s'avère cependant moindre que celle observée en moyenne en France de province. De même, la part représentée par le soutien public dans les dépenses d'innovation est significativement plus faible dans la région.
Une moindre tendance à solliciter l'intervention publique pourrait être à l'origine de cet écart. Dans le secteur des services, les entreprises mettent en avant, dans leurs réponses à l'enquête, la lourdeur excessive des démarches à effectuer pour expliquer qu'elles ne sollicitent pas un soutien public.
Les entreprises ayant été technologiquement innovantes au cours des deux périodes d'enquête ont bénéficié d'un soutien public significativement plus marqué que l'ensemble des entreprises, l'écart avoisinant dix points. En effet, les entreprises qui innovent le plus ont sans doute une meilleure connaissance des différents outils à leur disposition pour financer leurs activités d'innovation et ont davantage recours au soutien public.
graphiqueFigure 4 – Une entreprise sur deux a recours au financement public

- Note de lecture : entre 2010 et 2012, parmi les entreprises technologiquement innovantes, 52%ont eu recours à au moins un mode de financement public.
- Remarque : réponse multiple possible.
- Source : Insee, enquête CIS 2012, champ des entreprises technologiquement innovantes, mono et quasi monorégionales de moins de 250 salariés
Crédit d'impôt recherche et autofinancement : deux modes de financement privilégiés
Parmi l'ensemble des aides publiques, le Crédit d'impôt recherche est de loin la plus fréquemment perçue par les entreprises régionales technologiquement innovantes. 43 % d'entre elles ont bénéficié du Crédit d'impôt recherche (définitions) ou d'une autre forme d'exonération fiscale (figure 4). Le Crédit d'impôt recherche est accordé aux entreprises envisageant d'engager des dépenses de recherche fondamentale ou expérimentale, qu'il s'agisse de frais de rémunération ou de contrats passés avec des organismes extérieurs. En Nord-Pas-de-Calais, les entreprises bénéficiant de ce type d'aide comptent généralement plus de 50 salariés, appartiennent au secteur tertiaire, et interviennent en particulier dans le registre de l'information et de la communication.
Le financement de l'innovation technologique s'appuie cependant majoritairement sur la capacité d'autofinancement des entreprises. La possibilité de dégager un excédent brut d'exploitation et de s'asseoir sur une base financière solide fournit la capacité de réaliser des investissements en matière d'innovation, en même temps qu'elle garantit en parallèle les éventuels emprunts contractés dans le même objectif. Ainsi, près de 70 % des entreprises innovantes ont financé une part de leurs activités d'innovation grâce à leur capacité d'autofinancement (figure 4).
Des collaborations nombreuses, réalisées avec des partenaires de proximité
Près d'un tiers des entreprises régionales technologiquement innovantes ont mis en place une démarche de coopération active avec d'autres unités ou organismes. Parmi ces entreprises, quatre sur dix comptent plus de 50 salariés et huit sur dix appartiennent au secteur industriel.
Les collaborations s'effectuent très majoritairement avec des acteurs géographiquement proches. Les plus importantes d'entre elles ont ainsi été réalisées avec des partenaires de proximité : plus de 60 % s'effectuent avec des collaborateurs régionaux ou picards.
La moitié des entreprises déclare avoir mis en œuvre une coopération avec l'un de ses fournisseurs (figure 5). Ce partenariat apparaît comme le plus important pour près d'un tiers des entreprises innovantes. La région présente également une tendance importante aux partenariats publics, en particulier avec les universités, mais aussi avec les organismes publics de R&D. Ainsi, plus de 30 % des entreprises innovantes déclarent collaborer avec des centres universitaires. Ces proportions importantes ne s'écartent pour autant pas significativement des moyennes observées pour les autres régions. Les acteurs publics trouvent de manière générale une place honorable parmi les partenaires jugés les plus importants en matière d'innovation.
L'appartenance à un pôle de compétitivité influence très fortement la propension à innover d'une entreprise. En 2012, 72 % des entreprises appartenant à un pôle sont technologiquement innovantes, contre 35 % pour celles qui n'y appartiennent pas. Les entreprises des pôles ont une tendance à coopérer deux fois plus marquée que les autres, notamment avec les organismes de recherche, et sont également proportionnellement beaucoup plus nombreuses à bénéficier de fonds publics.
graphiqueFigure 5 – Les acteurs publics occupent une place non-négligeable dans les partenariats

- Note de lecture : entre 2010 et 2012, parmi les entreprises innovantes ayant coopéré avec d'autres organismes, 49 % ont mené cette coopération avec un fournisseur. Remarque : réponse multiple possible.
- Source : Insee, enquête CIS 2012, champ des entreprises technologiquement innovantes, mono et quasi monorégionales de moins de 250 salariés
Les secteurs dits innovants s'entendent ici au sens de l'OCDE. Ils concernent les secteurs d'activités liés aux technologies de l'information et de la communication, aux produits pharmaceutiques, aux biotechnologies et aux nouveaux matériaux.
Méthodologie
L'objectif de l'enquête communautaire sur l'innovation – dite CIS (Community Innovation Survey) – est de collecter une information détaillée sur l'innovation des entreprises, qu'il s'agisse d'innovation technologique (produit, processus) ou non technologique (marketing, organisation). Elle porte sur la période d'observation allant de 2010 à 2012, et couvre le champ des entreprises marchandes et exploitantes de 10 salariés ou plus. Le questionnaire de l'enquête CIS 2012 a été envoyé par voie postale ou électronique à un échantillon d'environ 15 000 entreprises.
Le champ de l'extension régionale se restreint aux entreprises de 10 à 249 salariés, mono et quasi mono régionales, intervenant dans les secteurs de l'industrie (y compris énergie) et des services intellectuels et technologiques. En termes de taille, ce champ s'apparente donc à celui des PME, sans prise en compte des caractéristiques financières aujourd'hui associées à ce profil d'entreprises.
L'échantillon régional comporte 1 500 questionnaires.
Afin de pouvoir étudier les évolutions enregistrées par la région entre l'enquête CIS 2008 et celle de 2012, l'identification d'un champ constant a été nécessaire. Ces entreprises nordistes présentes et répondantes lors des deux années d'enquêtes sont au nombre de 394. Les secteurs d'activités retenus lors des deux extensions d'enquêtes étant partiellement distincts, une analyse des évolutions constatées menée sur l'ensemble des entreprises interrogées les deux années n'aurait pas été significative.
Définitions
Conformément à la définition européenne, sont considérées comme innovantes les entreprises qui ont introduit un changement significatif ou une nouveauté dans au moins une des quatre catégories d'innovation possibles (produits, procédés, organisation, marketing), ou qui ont entrepris des activités d'innovation, que celles-ci aient conduit ou non à une innovation sur la période de référence.
L'innovation de produits consiste pour une entreprise à mettre sur le marché un produit nouveau (bien ou service) ou significativement modifié par rapport aux produits précédemment élaborés par l'entreprise, même si ce type de produits était déjà proposé sur le marché.
L'innovation de procédés consiste à introduire dans l'entreprise un procédé de production, une méthode concernant la fourniture de services ou la livraison de produits, une activité de support, nouveaux ou significativement modifiés.
L'innovation d'organisation consiste en une nouveauté ou une amélioration significative apportées au fonctionnement de l'entreprise (y compris la gestion des connaissances), à la méthode d'organisation du travail ou à ses relations externes.
L'innovation de marketing consiste à mettre en œuvre des concepts ou des stratégies de vente nouveaux ou qui diffèrent significativement des méthodes de vente existant dans l'entreprise.
L'innovation technologique : une entreprise est dite technologiquement innovante lorsqu'elle est innovante en produits ou en procédés ou lorsqu'elle a entrepris des activités d'innovation dans ces domaines, que celles-ci aient conduit ou non à une innovation.
Le Crédit d'impôt recherche est une mesure fiscale créée en 1983, pérennisée et améliorée par la loi de finances 2004 et à nouveau modifiée par la loi de finances 2008. Elle a pour but de baisser le coût des opérations de recherche-développement des entreprises. Le Crédit d'impôt recherche soutient leur effort de recherche-développement afin d'accroître leur compétitivité.
Pour en savoir plus
« Les sociétés exportatrices sont plus innovantes que les autres », Insee Première n°1521, octobre 2014.
« L'innovation des PME tient aussi à leur implantation régionale », Insee Focus n°12, octobre 2014.
« Innover pour résister à la crise ou se développer à l'export », Insee Première n°1420, octobre 2012.
« Les sociétés innovantes de 10 salariés ou plus - Quatre sur dix entre 2006 et 2008 », Insee Première n°1314, octobre 2010.
« Innovation en Nord-Pas-de-Calais : un potentiel à optimiser », Pages de Profils n°79, octobre 2010.